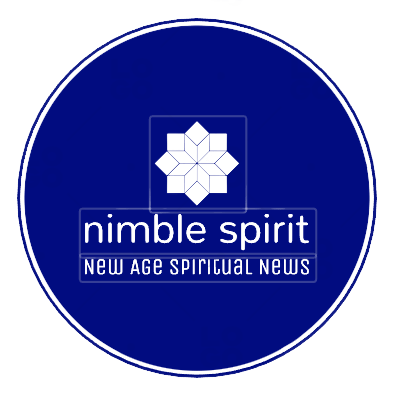>>>
Retrouvez ici tous les autres romans de la collection “Feuilletez avec les oreilles”
Publié en 2008, Les Années d’Annie Ernaux peut être considéré comme une synthèse de toute son œuvre. Elle qui a écrit sur son enfance dans Les Armoires vides (1974), sur son père (La Place, 1983), sa mère (Une femme, 1988), sur son avortement dans L’Evénement (2000), se lance dans l’écriture d’une fresque sociale et politique à partir de souvenirs personnels.
Le projet des Années date de 1985, il a été long à réaliser moins pour des raisons « documentaires » d’accumulation et de reconstitution des événements que pour une raison formelle, à savoir trouver quelle voix allait raconter le passage des années. Fallait-il dire « je » ? Annie Ernaux s’est longuement posé la question pour finalement parvenir à une écriture plus distanciée mêlant le « on », le « elle » et le « nous ».
À partir de photographies et de films, elle égrène le temps qui file de 1941 à 2006. De ce matériau personnel et familial, Annie Ernaux n’écrit pas qu’un récit autobiographique : c’est l’évolution de la société française tout au long de cette deuxième moitié du vingtième siècle qu’elle nous propose. C’est aussi et avant tout la parole d’une femme – thème qui lui est cher – qui est révélée ici ; celle d‘une femme inscrite dans sa génération, d’une femme issue d’un milieu provincial, modeste et catholique (« On vivait de la rareté de tout », écrit-elle) devenue une petite bourgeoise grâce à l’ascenseur social.
Dans cette autobiographie éminemment sociale et politique, l’histoire de la condition féminine n’est pas le seul vecteur du récit d’une vie. L’écrivaine aborde de nombreux thèmes comme la fin de la guerre, la montée en puissance de la publicité et l’avènement de la société de consommation, les années Mitterrand, le passage à l’Euro ou encore l’arrivée d’internet.
Parmi tous les sujets convoqués par Annie Ernaux dans cette exploration de la mémoire intime et collective, nous en avons choisi sept (un par décennie) que nous avons illustrés d’archives d’émissions de France Culture pour nous replonger encore un peu plus dans ces souvenirs ou pour éclairer des événements mal connus ou oubliés.
De la destruction du Havre en 1944 à la révolution des ordinateurs personnels, en passant par le 17 octobre 1961 ou encore l’expansion des banlieues pavillonnaires, retour sur sept décennies d’une vie : celle d’Annie Ernaux et un peu la nôtre.

Les années 40 : Le Havre rasé
“Ils n’en avaient jamais assez de raconter l’hiver 42, glacial, la faim et le rutabaga le ravitaillement et les bons de tabac, les bombardements
l’aurore boréale qui avait annoncé la guerre
les bicyclettes et les carrioles sur les routes à la Débâcle, les boutiques pillées
les sinistrés fouillant les décombres à la recherche de leurs photos et de leur argent
L’arrivée des Allemands – chacun situait précisément ou, dans quelle ville -, les Anglais toujours corrects, les Américains sans-gêne, les collabos, le voisin dans la Résistance, la fille X tondue à la Libération
Le Havre rasé, où il ne restait plus rien, le marché noir
la Propagande
les Boches en fuite traversant la Seine à Caudebec sur des chevaux crevés
la paysanne qui lâche un gros pet dans un compartiment de train où se trouvent des Allemands et proclame à la cantonade « si on peut pas leur dire on va leur faire sentir »
Sur fonds commun de faim et de peur, tout se racontait sur le mode du « nous » et du « on ».”
(Les Années, p. 23)
Presque soixante ans après les bombardements de la ville du Havre en septembre 1944 par les alliés qui libéraient la France, des habitants se souviennent de cette pluie mortelle, de la ville rasée et des cadavres enfouis dans les décombres. Ils se souviennent aussi de ce qu’était Le Havre avant. Un portrait radiophonique de la ville qui se finit avec la lecture par Raymond Queneau d’un poème sur sa ville natale, “Le Havre de grâce”.
Le Havre 29 janvier 1945 : souvenirs des bombardements dans “Le monde en soi”. Une diffusion du 08/02/2003
1h 00

Les années 50 : le savoir immuable de l’école
“Publique, privée, l’école se ressemblait, lieu de transmission d’un savoir immuable dans le silence, l’ordre et le respect des hiérarchies, la soumission absolue : porter une blouse, se mettre en rang à la cloche, se lever à l’entrée de la directrice mais non d’une surveillante, se munir de cahiers, plumes et crayons réglementaires, ne pas répondre aux observations, ne pas mettre en hiver un pantalon sans une jupe par-dessus. Le droit de poser des questions n’appartenait qu’aux professeurs. Si l’on ne comprenait pas un mot ou une explication, c’était notre faute. On était fiers comme d’un privilège d’être contraints à des règles strictes et à l’enfermement. L’uniforme imposé par les institutions privées constituait la marque visible de leur perfection.
Les programmes ne changeaient pas, Le Médecin malgré lui en sixième, Les Fourberies de Scapin, Les Plaideurs et Les Pauvres Gens en cinquième, Le Cid en quatrième, etc., ni les manuels, Malet-Isaac pour l’histoire, Demangeon la géographie, Carpentier-Fialip l’anglais. Ce bloc de connaissances était délivré à une minorité, confortée d’année en année dans son intelligence et son élévation, de rosa rosam à Rome l’unique objet de mon ressentiment, en passant par la relation de Chasles et la trigonométrie au lieu que le plus grand nombre continuait à faire des problèmes de trains et du calcul mental, à chanter La Marseillaise pour l’oral du certificat. Avoir celui-ci, ou le brevet, était un événement, salué dans les journaux qui publiaient le nom des lauréats. Ceux qui échouaient mesuraient précocement le poids de l’indignité, ils n’étaient pas capables. L’éloge de l’instruction partout dans les discours recouvrait sa distribution parcimonieuse.“
(Les Années, p. 49-50)
Pour plusieurs générations de lycéens, les manuels de littérature Lagarde et Michard sont dans toutes les mémoires. Ils ont accompagné avec attirance ou répulsion notre apprentissage de l’histoire littéraire française grâce aux morceaux choisis qui étaient proposés. C’est le sujet de ce “Lieux de mémoire” que nous raconte Philippe Garbit avec entre autres le témoignage d’André Lagarde.
Le manuel Lagarde et Michard, naissance et influence dans “Lieux de mémoire”. Une diffusion du 01/02/1996
59 min

Les années 60 : un 17 octobre 1961 ignoré
“Cependant, ils manifestaient toujours crainte, au mieux d’indifférence, à l’égard des « Arabes ». Ils les évitaient et les ignoraient, n’ayant jamais pu se résigner à côtoyer dans leurs rues des individus dont les frères assassinaient des Français de l’autre côté de la Méditerranée. Et le travailleur immigré, quand il croisait les Français, savait -plus vite et plus clairement qu’eux- qu’il portait le visage de l’ennemi. Qu’ils vivent dans des bidonvilles, bossent sur des chaînes ou au fond d’un trou, que leur manifestation d’octobre soit interdite, puis matée avec la plus extrême violence, et même peut-être, si on l’avait appris, qu’une centaine d’entre eux soient balancés paraissait dans la Seine paraissait dans l’ordre des choses. [Plus tard, quand on apprendrait ce qui s’était passé le 17 octobre 61, on serait dans l’incapacité de dire ce qu’on avait su à l’époque des faits, ne retrouvant rien, sinon le souvenir d’une douceur du temps, de la proche rentrée universitaire. Eprouvant le malaise de ne pas avoir su – même si l’Etat et les journaux avaient tout fait pour cela – comme si l’ignorance et le silence ne se rattrapaient jamais. Et on aurait beau faire, il n’y aurait pas de lien de similitude entre la charge haineuse de la police gaullienne contre les Algériens en octobre et celle de février contre les militants anti-OAS. Les neuf morts du métro Charonne plaqués contre les grilles et les morts indomptés de la Seine ne se rejoindraient pas.]”
(Les Années, p. 82-83)
Des témoins des manifestations du 17 octobre 1961 contre le couvre-feu imposé aux Algériens en France se souviennent de cette nuit-là. Ce drame les a marqués à vie, quarante après l’émotion resurgit. Ils racontent les mouvements de foule, les coups de feu, la panique, les bousculades, les corps par terre puis les cars de CRS remplis d’Algériens devant le Palais des Sports transformé en camp de rétention.
L’ombre de la disparition, l’escamotage du 17 octobre 1961 (extrait) dans “Le monde en soi”. Une diffusion du 03/11/2001
37 min
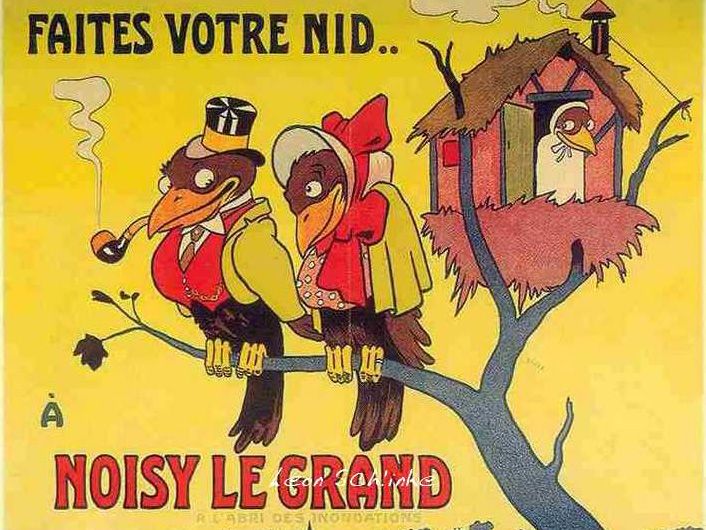
Les années 70 : la modernité pavillonnaire
“On partait. On s’installait dans une ville nouvelle à quarante kilomètres du périphérique. Une maison légère dans un lotissement en voie d’achèvement, coloré comme un village de vacances, avec des rues aux noms de fleurs. La porte en claquant faisait un bruit de bungalow. C’était un endroit silencieux, à découvert sous le ciel d’Île-de-France, en bordure d’un champ traversé par un défilé de pylônes.
Plus loin, il y avait des espaces herbeux, des immeubles de verre et des tours administratives, une dalle piétonne, d’autres lotissements reliés par des passerelles au-dessus des voies de circulation. Il était impossible de se figurer les limites de la ville. On se sentait flotter dans un espace trop vaste, l’existence se diluait. Se promener Ià n’avait pas de sens, à la rigueur courir en survêtement sans rien regarder autour de soi. On gardait dans Ie corps l’empreinte de la ville ancienne, des rues avec des voitures et des passants sur les trottoirs.
En migrant de la province à Ia région parisienne, le temps s’était accéléré. Le sentiment de la durée n’était plus le même. Le soir venu, on avait l’impression de n’avoir rien fait, sinon de vagues cours à des classes énervées.”
(Les Années, p.132)
“La tyrannie pavillonnaire” était le sujet de l’émission “Staccato” en 1999. Antoine Spire interrogeait ce désir si fort d’une maison à soi avec l’architecte Paul Chemetov et l’urbaniste Claude Eveno. “Le pavillon, c’est un moment de la vie”, résumait ce dernier car l’attraction de la ville reste toujours présente.
La tyrannie pavillonnaire (extrait) dans l’émission “Staccato”. Une diffusion du 21/06/1999
17 min

Les années 80 : contre la loi Devaquet, un goût de Mai 68 en hiver
“Parce qu’il avait déjà eu lieu, et qu’on l’avait connu, on a pensé que c’était un événement quand les étudiants et les lycéens sont descendus dans la rue deux mois après contre la loi Devaquet. On n’osait espérer, on s’émerveillait, Mai 68 en hiver, on prenait un coup de Jeune. Mais ils nous remettaient à notre place, sur les calicots ils écrivaient 68 c’est vieux 86 c’est mieux. On ne leur en voulait pas, ils étaient gentils, ne lançaient pas de pavés et s’exprimaient posément à la télévision, chantaient dans les manifs des couplets qui nous ravissaient sur l’air du Petit navire et de Pirouette cacahouète – il fallait être Pauwels et Le Figaro pour les déclarer atteints de « sida mental ». Pour la première fois, on voyait dans sa réalité massive, impressionnante, la génération d’après la nôtre, les filles en première ligne avec les garçons, les Beurs, tout le monde en jean. Le nombre les rendait adultes, étions-nous si vieux déjà. Un garçon de vingt-deux ans qui ressemblait sur les photos à un enfant mourait sous les coups des voltigeurs de la police rue Monsieur-le-Prince. On défilait sombrement par milliers derrière les banderoles avec son nom, Malik Oussekine. Le gouvernement retirait la loi, les manifestants retournaient à la fac et au lycée. Ils ne voulaient pas changer la société, seulement qu’il ne leur soit pas mis des bâtons dans les roues pour s’y faire bonne place.”
(Les Années, p.171)
Durant l’hiver 1986, les étudiants et les lycéens descendent dans la rue dans un contexte politique où la droite a gagné les élections législatives et le ministre délégué à l’Enseignement supérieur, Alain Devaquet, fait passer un projet de loi qui prône plus d’autonomie pour les universités. Une étudiante de l’époque raconte ces manifestations au micro d’Amélie Meffre, notamment les incidents violents et la mort dramatique de Malik Oussekine.
Histoire de la rue : les manifestations lycéennes (extrait) un documentaire dans “La nouvelle fabrique de l’histoire”. Une diffusion du 30/08/2005
13 min

Les années 90 : la peur du Sida
“De toutes les peurs répertoriées, celle du sida était la plus forte. Les visages émaciés et transfigurés des mourants célèbres, d’Hervé Guibert à Freddie Mercury – dans son dernier clip tellement plus beau qu’avant avec ses dents de lapin -, manifestaient le caractère surnaturel du « fléau » premier signe d’une malédiction jetée sur la fin du millénaire, un jugement dernier. 0n s’écartait des séropositifs – trois millions sur la terre – et l’État s’évertuait en spots moraux à nous convaincre de ne pas les prendre pour des pestiférés. La honte du sida en remplaçait une, oubliée, de la fille enceinte sans être mariée. Etre soupçonné de l’avoir valait condamnation, Isabelle Adjani a-t-elle le sida ? Rien que passer le dépistage était suspect, l’aveu d’une faute indicible. On le faisait en cachette à l’hôpital sous un numéro, sans regarder ses voisins de salle d’attente. Seuls les contaminés par transfusion dix ans plus tôt avaient droit à la compassion et les gens se soulageaient de la peur du sang des autres en applaudissant à la comparution en Haute Cour de ministres et d’un médecin pour « empoisonnement ». Mais, somme toute, on s’accommodait. On prenait l’habitude d’avoir un préservatif dans son sac. On ne le sortait pas, l’idée de s’en servir paraissant d’un seul coup inutile, une insulte au partenaire – regrettant aussitôt après, passant le test, attendant le résultat avec la certitude qu’on allait mourir.”
(Les Années, p.194-195)
Dans ce “Nuits magnétiques” diffusé l’été 1988, Pascale Charpentier nous propose un documentaire vibrant sur ces premières années de la propagation du Sida en France où les angoisses les plus primitives ont ressurgi : peur pour la société, peur de l’autre, angoisse du dépistage, retour de la grande peste… Sida, la nouvelle grande peur, c’est ce qu’on entend dans les témoignages de malades, de médecins, de psychologues et de militants associatifs.
Voyage au bout de la nuit. Sida juillet 88 : peurs, troubles et fantasmes (4/4) dans “Nuits magnétiques”. Une diffusion du 22/07/1988
1h 10

Les années 2000 : l’exigence de l’ordinateur
“Le vrai courage technologique était de « se mettre » à l’ordinateur dont la manipulation signifiait un degré supérieur d’accès à la modernité, une intelligence différente, nouvelle. Un objet impérieux exigeant des réflexes rapides, des gestes de la main d’une précision inhabituelle, proposant sans arrêt dans un anglais incompréhensible des « options » auxquelles il fallait obtempérer sans délai – un objet implacable et maléfique qui cachait dans le tréfonds de son ventre la lettre qu’on venait d’écrire, qui jetait dans une constante perdition. Qui humiliait. Contre lequel on se rebiffait, « qu’est-ce qu’il me fait encore ! ». Le désarroi s’oubliait. On achetait un modem pour avoir Internet et une adresse électronique, éblouis de « naviguer » dans le monde entier sur Alta Vista.
Il y avait dans les nouveaux objets une violence pour le corps et l’esprit que l’usage effaçait rapidement. Ils devenaient légers. (Comme d’habitude, les enfants et les adolescents les utilisaient avec facilité et sans questions.)
La machine à écrire, son cliquetis et ses accessoires, l’effacil, le stencil et le carbone, nous paraissaient relever d’une époque lointaine, impensable. Pourtant, quand on se revoyait, quelques années plus tôt, en train de téléphoner à X dans les toilettes d’un café, de taper un soir une lettre à P sur l’Olivetti, il fallait bien reconnaître que l’absence de portable et de mail ne tenait aucune place dans le bonheur ou la souffrance de la vie.”
(Les Années, p.208)
L’émission “Place de la toile” était consacrée en 2008 à la manière dont le futur technologique était imaginé autrefois. De nombreuses archives sonores des années 1950 à la fin des années 1980 illustrent les propos de Michel Puech, maître de conférence en philosophie, et Paul Braffort, scientifique, qui abordent notamment l’histoire de l’ordinateur, les prémices du numérique et le développement de l’informatique domestique.
C’était comment le futur, avant ? dans l’émission “Place de la toile”. Une diffusion du 25/04/2008
51 min
We would like to say thanks to the writer of this post for this incredible material
Feuilletez “Les Années” d’Annie Ernaux avec les oreilles
We have our social media profiles here as well as other pages on related topics here.https://nimblespirit.com/related-pages/