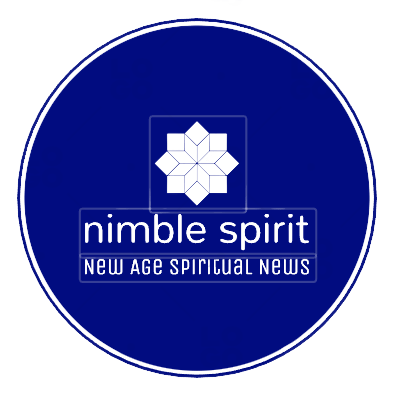Les cigarettes qu’il grille aujourd’hui sont celles d’un patriarche. Chef de famille, de village aussi, sur des terres camerounaises qu’il avait quittées à 12 ans pour tenter sa chance dans le grand monde du tennis. Yannick Noah en a désormais 62, un âge qui permet de se retourner et de contempler un destin unique mais protéiforme. Le passage à la soixantaine, il l’a vécu en plein confinement, dans sa maison des Yvelines. « Seul avec ma fille, un plat de riz au beurre et un Haut-Brion. À ranger aussi mes souvenirs, à ouvrir des malles de photos. » À l’aise tant avec les gamins des cités qu’avec les politiques, il continue de parler des premiers aux seconds, mais il prend également le temps. Pour traverser les mers sur un catamaran ou visiter ses enfants et petits-enfants « éparpillés ». Trois ans que le Noah chanteur n’avait plus donné de nouvelles. Depuis cet été, il a retrouvé le chemin des concerts, prélude à la sortie d’un 12e album, La Marfée.
Votre album n’est pas encore sorti, mais vous êtes en tournée depuis juin. La scène vous a manqué ?
C’est toujours la même histoire. Quand la tournée débute, je grogne un peu, car je laisse ma vie qui est cool. Mais dès les premiers concerts, c’est la piquouse du bonheur, le shoot d’adrénaline, on ne se refait pas. D’ailleurs, je ne ressens jamais le trac avant de monter sur scène. Ce n’était pas le cas avec le tennis, où la sentence est de paumer. Autant gagner est puissant, autant perdre est douloureux. Durant ma carrière, j’ai dû jouer 200 tournois, j’en ai remporté 23. Ça en fait, des jours difficiles… Avec la musique, je partage une communion, c’est comme une messe en famille. Aujourd’hui encore, on me dit : « Mais putain, tu as la patate ! » Je réponds simplement : « Les gars, je suis content d’être là, je kiffe. »
“
La musique m’a beaucoup aidé après ma victoire à Roland-Garros. J’avais atteint mon Graal, je n’avais plus de rêves, il fallait relancer la machine
“
Vous vous souvenez de vos premiers émois musicaux ?
Mes parents étaient mélomanes. Mon père écoutait beaucoup de musique afro-cubaine, camerounaise, c’était un ambianceur. Ma mère avait souvent le mal du pays, alors elle passait beaucoup de chanson française : Brassens, Brel, Mouloudji, Moustaki… Bien sûr, elle pouvait danser sur du makossa, elle était la plus camerounaise des Françaises. Quand elle écoutait ses disques, elle n’était plus au Cameroun, mais en France. Quand, à 12 ans, je me suis retrouvé en pension à Nice pour devenir tennisman, j’ai aussi ressenti ce blues du pays. Dans cette vie de solitude, la musique était un refuge. À l’époque, le rêve fou était déjà de chanter dans un groupe. Je me souviens d’un concert de Téléphone, j’avais tellement envie de les rejoindre sur scène. Des années plus tard, Jean-Louis Aubert m’a écrit des chansons ; on a même partagé un voyage en mer, à chanter toute la journée, lui en maillot de bain, assis en tailleur avec sa guitare.
Lire aussi – « Plein de sportifs ont eu des moments de déprime » : Yannick Noah se livre sur la santé mentale dans le sport
La musique a joué un rôle durant votre carrière sportive ?
Avant un match, je n’écoutais rien, sinon le silence. Pour l’anecdote, j’ai été le premier mec en France à posséder un Walkman. J’avais fait une exhibition à Tokyo et « monsieur Sony » avait créé un prototype afin de pouvoir jouer au golf en écoutant de la musique. J’étais revenu en France avec cette petite boîte bleue et ses écouteurs en mousse orange. Tennis Magazine avait écrit : « Si vous voyez Yannick Noah déambuler en dansant tout seul dans la rue, c’est grâce à une nouvelle invention, le Walkman. » Plus sérieusement, la musique m’a beaucoup aidé après ma victoire à Roland-Garros. J’avais atteint mon Graal, je n’avais plus de rêves, il fallait relancer la machine et je l’ai fait grâce à la sophrologie et au rock. J’écoutais AC/DC, les Rolling Stones, les Who, Ten Years After, les Beatles… Ça m’a permis de travailler mon attitude pour entrer sur le terrain comme une star. Plus tard, quand je me suis lancé dans la musique, mes premières maquettes étaient d’ailleurs assez rock’n’roll.
Le public, lui, l’était moins…
Il venait à mes concerts pour voir le joueur de tennis qui chantait Saga Africa. On arrivait dans des endroits, les gens étaient déguisés en Africains, mais nous on jouait du rock. Ils étaient un peu déçus, mais nous, on s’éclatait. En plus je chantais en anglais, par pudeur… Jusqu’au jour où tu rencontres la bonne personne qui te dit : « Yann, on va te faire un album en français. » C’était chaud, car j’avais l’impression de me mettre à nu.
“
Avec Robert et Jean-Jacques Goldman, on a vite sympathisé au point de jouer au tennis ensemble
“
Vous parlez de Robert Goldman, le frère de Jean-Jacques ?
Oui. Il m’a écrit l’album Yannick Noah en 2000. Grâce à lui, je suis vraiment devenu chanteur. Il a capté ma personnalité et mes aspirations profondes. Avec la chanson Simon Papa Tara, dédiée à mon grand-père, je suis passé des MJC aux Zéniths. Pour ce nouvel album, j’avais envie de me retrouver en famille, donc je l’ai appelé, alors que nous n’avions plus collaboré depuis dix ans. Je me souviens encore de notre première rencontre, lors d’un concert pour les Enfoirés. Avec Robert et Jean-Jacques, on a vite sympathisé au point de jouer au tennis ensemble. D’ailleurs Jean-Jacques, avant de se lancer dans la musique, travaillait dans comme cordeur de raquettes…
Et il est comment sur un court ?
C’est très marrant de le voir jouer. Il a un style unique de gaucher, il ne lâche rien ! Il m’avait aussi écrit une chanson, Ni divin ni chien. Quel cadeau !
Il fait partie de vos successeurs comme personnalité préférée des Français dans le Top 50 du JDD
. Que vous inspire le podium qu’il forme avec Thomas Pesquet et Omar Sy ?
Ils sont rassembleurs, les gens ont besoin de ça…
Alors que vous êtes devenu clivant ?
À une époque, j’étais en guerre contre une certaine bourgeoisie parisienne. Je m’occupais de mes associations pour les enfants des quartiers [Fête le mur et Les Enfants de la Terre]. Entre mon image et mes convictions humanitaires, un truc n’allait pas. Je ne voulais plus être le nègre de service, je voulais exprimer des choses. Je peux me tromper, dire des conneries, mais si on me pose une question, je réponds. Et pendant ce temps, je me fais chier à écouter des gens qui disent toujours les mêmes choses, à commencer par les sportifs. Je suis donc passé de numéro un
à… inexistant !
“
Les Ardennes, c’est aussi toute mon enfance : on avait de la famille à Aiglemont, un petit village près de Charleville-Mézières
“
Interprétez-vous toujours sur scène Ma colère,
votre manifeste contre le Front national ?
Non. Les gens ne sont pas prêts, ils subissent. Quand j’ai fait cette chanson, j’étais personnalité préférée des Français, j’avais un pouvoir de faire du bien, de rassembler les Noirs et les Blancs, c’est toute mon histoire. Mais je me suis fait défoncer sur les réseaux sociaux : tout à coup, j’étais un Africain, on m’invitait à rentrer chez moi, on me traitait d’exilé fiscal… Tous ces éléments de langage qui reviennent depuis vingt ans.
Pourquoi ce titre d’album, La Marfée, nom d’une forêt près de Sedan ?
C’est surtout un clin d’œil à maman, et aux Ardennais. Au Cameroun, elle avait en elle une espèce de manque, elle parlait souvent de cet endroit. Et quand elle a créé son école [dans le jardin familial], un premier bungalow pour 12 gamins, elle l’a appelée ainsi. Cette année, on fête les 50 ans, avec désormais 500 gamins. Pour moi, les Ardennes, c’est aussi toute mon enfance : on avait de la famille à Aiglemont, un petit village près de Charleville-Mézières, on partait du Cameroun pour y passer un mois l’été, à s’amuser avec des bateaux en papier sur le ruisseau et faire des cabanes en fougères.
Vous voilà aujourd’hui revenu à Etoudi, le village où vous avez grandi. À quoi ressemblent vos journées là-bas ?
Le village est devenu un quartier, très étendu, en bordure de Yaoundé. J’habite une oasis de nature dans la ville. Dernièrement, on a rénové l’école pour la rentrée des classes. Il y a aussi la construction d’un dispensaire pour soigner les vieux gratuitement, une salle de gym. Le rythme est différent. Je ne suis pas en préretraite, mais presque.
“
Refuser le rôle de chef de village ne m’a même pas traversé l’esprit : c’était évident que je devais l’endosser
“
Comment en êtes-vous devenu le chef ?
C’est un truc culturel, donc je vais l’expliquer avec les mots d’ici. Je suis la réincarnation de mon grand-père Simon. Il vit à travers moi. Comprenne qui pourra, mais au Cameroun c’est évident. Les vieux me parlent comme ils parleraient à mon grand-père. À sa mort, même ma grand-mère me disait : « Tu es mon mari. » Pour moi et ma culture occidentale, c’était perturbant, mais ça prend un sens avec le temps. Je me souviens des petits mots de mon grand-père, des signes qu’il m’envoyait… Refuser le rôle ne m’a même pas traversé l’esprit : c’était évident que je devais l’endosser.
Une évidence pour tout le monde ?
Les palabres, ça fait partie de la tradition. Il fallait mettre des choses sur la table. « Est-ce qu’il est vraiment motivé et sensible à ce qu’on vit ? » « Est-ce qu’il va juste être là quinze jours par an ? » J’ai répondu pendant deux heures. C’était juste avant d’enterrer papa [en 2017], il y avait beaucoup de vibrations. Pendant trois jours et trois nuits, les gens viennent parler du défunt. Tu apprends des anecdotes, ça rigole, ça crie, ça pleure, ça danse. La mort est vécue comme un passage de l’autre côté, pas comme une fin. Mes enfants étaient là et c’était fabuleux.
“
Quand Emmanuel Macron s’est incliné sur la tombe de mon père et de mes ancêtres, j’ai craqué
“
Cet été, vous vous êtes aussi retrouvés là-bas à chanter devant Emmanuel Macron…
Ce n’était pas Emmanuel Macron, mais le président de la France, qui venait dans mon village. Et ça compte, la France. C’est incroyable de remporter un titre comme Roland-Garros pour deux pays à la fois. Puis l’équipe de France qui remporte la Coupe Davis cinquante-neuf ans après [en 1991, sous son capitanat] avec le stade entier qui chante Saga Africa… Ça défonce. Et c’est au-dessus de moi. J’ai souvent été invité à l’Élysée ou au palais présidentiel au Cameroun, mais cet été c’était encore différent. Quand Emmanuel Macron s’est incliné sur la tombe de mon père et de mes ancêtres, j’ai craqué. Je lui ai expliqué que mon grand-père, tirailleur, avait eu la Légion d’honneur française.
Vous-même, vous ne l’avez pas ?
Non, je ne suis pas reconnu ici. Alors que je peux vous dire que certains n’ont rien gagné, mais ils l’ont. On m’en a parlé il y a quelques années, sous François Hollande. J’ai dit : « Quel honneur ! », et puis voilà. Fin des haricots.
Au printemps prochain, les 40 ans de votre victoire à Roland-Garros, ça va vous faire drôle ?
Ça va surtout faire drôle à ceux qui pendant toute ma carrière disaient « Oui, Noah… Bof. » Oui, ça fait quarante ans et ce n’est pas demain la veille [qu’un Français lui succédera]. Pour marquer le coup lors de la prochaine édition, Gilles [Moretton, le président de la Fédération] a prévu quelque chose. C’est cool parce que j’ai pensé un moment qu’il n’y aurait jamais rien, même pas un truc symbolique… Il y a deux ans, j’étais à Roland avec mes enfants : dans le stade, il n’y avait rien de moi, si ce n’est une photo dans un couloir. Je me dis : « Quand je ne serai plus là, si mes gamins viennent à Roland, on va leur donner un ticket ou pas ? »
We would love to thank the author of this article for this remarkable material
Yannick Noah de retour avec un nouvel album : « Dès les premiers concerts, c’est le shoot d’adrénaline »
Check out our social media accounts as well as other pages related to themhttps://nimblespirit.com/related-pages/