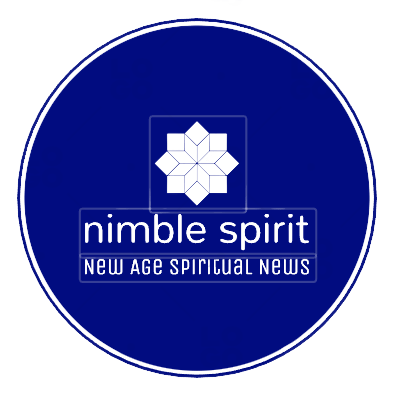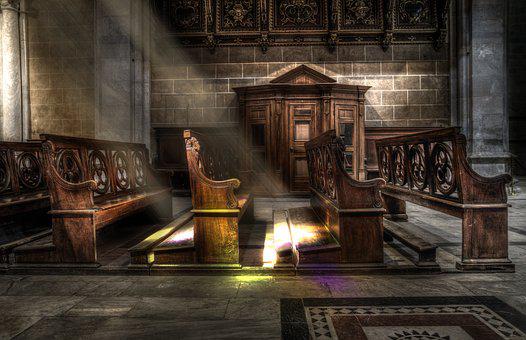Avec ses longs cheveux, sa barbe et son goût pour la folk, Charles Manson semble être l’incarnation même des années 1960, libertaires et révolutionnaires. Lorsqu’on se penche sur son parcours, l’homme né en 1934, d’un père inconnu et d’une mère prostituée et alcoolique, n’a pourtant rien d’un hippie persuadé que, main dans la main, le monde gambade vers des lendemains fleuris.
À 5 ans, alors que sa mère est envoyée en prison pour vol à main armée, Charles est placé chez sa tante et son oncle, jugés sadiques. À 16 ans, des médecins le qualifient d’«agressivement asocial», tandis qu’un psychiatre, deux ans plus tard, lui diagnostique un traumatisme psychique et une «grande sensibilité, blessée par une absence d’amour et d’affection».
Si le corps médical s’intéresse tant à Charles Manson, c’est précisément parce que ce dernier multiplie les allers-retours en prison. Qu’importe son épouse et l’arrivée d’un premier enfant, le jeune homme ne résiste pas à la tentation du mal (proxénétisme, vol, etc.) et passe la majorité de son temps derrière les barreaux. C’est là, en plein cœur des années 1950, qu’il apprend la guitare et le chant, fasciné par une nouvelle génération d’artistes dont il s’inspire. Plus tard, il compose même «A Tribute To Hank Williams», en hommage à la star de la country, tandis que des rumeurs prétendent que c’est David Allan Coe qui lui aurait appris la six cordes en prison, dans l’Ohio.
Charles Manson se croit extrêmement doué et compose compulsivement, à en croire l’autobiographie du gangster canadien Alvin Karpis: «Un gamin réclamait des cours de musique. Il voulait apprendre la guitare et devenir une star de la musique. “Little Charlie” était si paresseux que je ne le pensais pas capable de consacrer du temps à cet apprentissage. À ma grande surprise, il apprit vite.» On dit alors qu’il aurait enregistré quatre-vingt-dix titres en un an et qu’il est persuadé de pouvoir faire mieux que les Beatles, qu’il admire autant qu’il jalouse.
Des meurtres rituels
À sa sortie de prison, en 1967, Charles Manson traîne au sein de la scène musicale de Los Angeles. Il a une maison près du Topanga Canyon (plus tard acquise par le bassiste du Crazy Horse), se lie d’amitié avec Dennis Wilson, enregistre ses musiques grâce à Philip Kaufman et propose même l’une de ses chansons aux Beach Boys: «Cease To Exist», qui deviendra en décembre 1968 la face B de «Bluebirds Over the Mountain» sous le nom «Never Learn Not To Love».
Suffisant pour se réjouir? Pas vraiment: non crédité, Charles Manson est furieux d’entendre les modifications effectuées (y compris sur les paroles ou le pont) et souhaite le faire savoir. Dans la foulée, il envoie une balle par la poste au domicile de Dennis Wilson, lui indiquant qu’il devrait se réjouir d’avoir «des enfants en vie».
À ce moment-là, Charles Manson semble oublier tout ce qu’il doit au batteur des Beach Boys. C’est notamment ce dernier qui lui a permis de rencontrer Neil Young, le groupe The Mamas and The Papas, qui tente vainement de lui décrocher un contrat, le guitariste Bobby Beausoleil, futur assassin, ou encore différentes personnalités de l’industrie musicale, dont Terry Melcher.
À l’époque, l’homme derrière le succès des Byrds vit au 10050 Cielo Drive, une maison sur les hauteurs d’Hollywood où Manson traîne parfois. Ainsi, lorsque l’ex-taulard comprend que les discussions avec Melcher n’aboutissent à rien, le producteur prend peur. À raison: quelques semaines plus tard, en août 1969, on apprend que le meurtre de Sharon Tate et de ses amis, en pleine répétition avant un tournage à Londres, a eu lieu dans la maison de Terry Melcher, trop effrayé par les menaces de Manson pour rester dans les environs. Simple coïncidence? Pas du tout. Acte manqué? À coup sûr.
Au procès, ces crimes sont considérés comme des «meurtres rituels», commandités par Manson dans le but de se venger, mais aussi d’asseoir sa réputation auprès de ses fidèles, admiratifs de ses discours messianiques. Dans son autobiographie, Neil Young disait lui aussi avoir ressenti un mélange de fascination et d’effroi lors de sa première rencontre avec le leader de la Manson Family.
C’était en 1969, au domicile de Dennis Wilson: «À un moment, un gars s’est pointé, a pris ma guitare et s’est mis à chanter. Il s’appelait Charlie. Ses chansons étaient des trucs qu’il improvisait comme ça et il ne les jouait jamais deux fois de la même manière. Un peu à la Dylan, mais pas tout à fait parce qu’il n’y avait pas vraiment de message. Cela dit, les chansons avaient quelque chose d’envoûtant. Il était plutôt doué.»
Dans une interview avec le critique de rock Nick Kent, Neil Young poursuivait ce parallèle avec Dylan: «S’il avait eu un groupe comme celui de Dylan pour “Subterranean Homesick Blues”… Mais c’était inconcevable, il y avait quelque chose en lui qui empêchait les autres de rester trop longtemps à proximité.»
Des disciples, une prophétie
et des scarabées
Sûr de ses qualités et complètement ravagé par les drogues, Charles Manson ne doute à aucun moment de son potentiel. Il se rêve en rockstar, fantasme le mode de vie en tournée, mais peine à admettre que ses paroles puissent être malsaines et assurément glauques. Rien ne sert en effet d’avoir un bac+5 en psychologie pour comprendre que l’Américain, depuis sa sortie de prison en 1967, a totalement vrillé.
À ses proches, il se présente comme la réincarnation du Christ, vit de vols et du trafic de drogue et fonde la Manson Family, un harem de trente à cinquante personnes selon les périodes, constitué essentiellement de femmes qui, selon lui, auraient été placées sur Terre pour servir les hommes et satisfaire tous leurs besoins, y compris sexuels. Parmi elles, il y a notamment Susan Atkins, une strip-teaseuse toxicomane qu’il ne tarde pas à mettre enceinte.
À l’automne 1967, Manson embarque cette troupe à bord d’un vieux bus scolaire. Direction Los Angeles, où il enregistre Lie: The Love and Terror Cult, un album de folk psychédélique qui ne sortira finalement qu’en 1970, quelques semaines avant sa condamnation à vie pour les meurtres commis lors de l’été 1969, qu’il justifie vaguement par l’écoute compulsive du White Album des Beatles. Notamment deux morceaux: «Helter Skelter», dont il reprend le titre pour nommer son groupe criminel, et «Piggies», persuadé de voir un signe, voire un appel au meurtre, dans ce passage où George Harrison s’en prend à l’establishment américain: «Ce dont ils ont besoin, c’est d’une sacrée bonne raclée».
Paraîtrait même que ceux qui ont participé au massacre du 10050 Cielo Drive auraient chanté en chœur ces paroles une fois dans la voiture… C’est le cas de Linda Kasabian, celle qui a inspiré un groupe anglais à adopter le même nom au début des années 2000, celle qui confiait également, dans un témoignage retranscrit par John Gilmore et Ron Kenner dans The Garbage People, que Manson a forcé une fille de 15 ans à lui faire l’amour devant toute la Family, avant d’inviter les hommes de la communauté à faire de même avec la jeune adolescente.
Mais revenons-en aux Beatles. Charles Manson en est certain: leurs paroles font office de prophétie, elles annoncent le déclin de la race blanche. «Cette musique déclenche la révolution, la chute non organisée de l’ordre social», déclare-t-il en 1970 au magazine Rolling Stone.
Des propos complétés par celui de Paul Watkins, un membre de la Manson Family, dans son livre My Life With Charles Manson: «Depuis le début, Charlie croyait que la musique des Beatles nous transmettait un message important. Il a déclaré que leur album The Magical Mystery Tour exprimait l’essence de sa propre philosophie. En gros, Charlie voulait nous programmer pour qu’on se soumette tous: qu’on abandonne notre ego, ce qui, d’un point de vue spirituel, est une noble aspiration. On était des rebelles au sein d’une culture matérialiste et décadente.»
Dans ses chansons, toujours très dépouillées et verbeuses, Charles Manson poursuit la même ambition. Ainsi de «Mechanical Man», où il chante: «Je te vois là, Joe/Et tu penses que ton nom est Joe/Je te vois là, Sam/Et tu penses que ton nom est Sam/Tu n’es pas Joe, tu n’es pas Sam/Tu es juste moi.»
Une discographie souterraine
Le gourou se voit alors en sauveur, et envisage chacun des sept meurtres perpétrés par ses adeptes comme un moyen de faire accuser la population noire, «ces nègres qui ne savent faire que ce que l’homme blanc leur a appris ou montré». En vain: c’est en prison que Manson passa le reste de sa vie, avec une croix gammée incisée sur le front, des pensées morbides plein la tête, mais sans jamais mettre de côté la musique.
White Rasta en atteste: enregistré dans sa cellule, cet album sort en cassette en 1983, avant d’être commercialisé sous le titre Live At San Quentin une décennie plus tard, accompagné d’une pochette parodiant volontairement celle de Pet Sounds des Beach Boys.
Ce qu’on y entend? Les complaintes d’un homme qui, seul avec sa guitare, multiplie les références à la pop culture («Marilyn Monroe Was My Childhood Shame», «My Name Is Sam McGee»), les instantanés («So Today Has Been A Good Day»), les confessions intimes («And I’d Like To Say Hello To Some Of My Friends») et les diatribes surréalistes («I Got a Tough Bastard Child Want To Become Into a Samurai»).
D’autres labels, comme Pale Horse et White Devil Records, publient également différents enregistrements de Manson, sans doute attirés par la possible manne financière de ces projets. Dans le livret de Commemoration, White Devil Records dit que ce disque est censé marquer «soixante ans de combat contre la lâcheté, la bêtise et les mensonges».
Pale Horse se fait plus aguicheur encore en promettant, en 1998, dans le livret de The Way Of The Wolf, «plus d’une heure de musique inédite sortie de l’esprit de Charles Manson. Ces treize nouvelles chansons dévoilent des facettes de Manson qui avaient été dissimulées au public pendant plus d’un quart de siècle. The Way Of The Wolf lève un coin du voile sur la vie d’une légende américaine.»
On pourrait également mentionner The Songs Of Charles Manson, un disque enregistré par la Manson Family dans l’idée de promouvoir les écrits du leader, ou encore Manson Speaks, deux heures de spoken word enregistrées lors d’un séjour à la prison de Vacaville où l’on entend le gourou lire des poèmes ou des passages de la Bible, mais aussi disserter sur des sujets d’actualité (le procès d’O.J. Simpson, les droits des prisonniers, Rodney King, etc.).
Fascination morbide
À chaque fois, ces sorties sont interdites, peu exposées ou simplement peu écoutées. Car, au fond, ce qui fascine, ce sont moins les chansons de Charles Manson, trop souvent improvisées et loufoques pour séduire totalement, que son empreinte dans l’imaginaire collectif. En 1974, Neil Young sait s’en souvenir au moment de composer «Revolution Blues», où il se met dans la peau du meurtrier: «J’ai entendu dire que Laurel Canyon est plein de stars célèbres/Mais je les déteste plus que les lépreux et je les tuerai dans leurs voitures.»
En 1985, c’est Sonic Youth qui fait de Bad Moon Rising une ode impure à celui que ses adeptes surnommaient «le Magicien» et à ses délires morbides, tandis que Nine Inch Nails et Marilyn Manson, dont le pseudonyme est tiré de l’association entre Marilyn Monroe et Charles Manson, poussent le vice jusqu’à enregistrer respectivement Broken (1992) et Portrait Of An American Family (1993) dans la maison où Sharon Tate a été assassinée.
Côté hip-hop, plusieurs artistes ont également samplé des extraits de ses interviews, toujours riches en punchlines effrayantes, pour leurs morceaux («Death Grips», «The Game», «Lil Ugly Mane», etc.), mais c’est bien Axl Rose, le leader des Guns N’ Roses, qui est possiblement allé le plus loin: en interprétant «Look At Your Game, Girl», un morceau extrait de Lie: The Love and Terror Cult, en s’affichant sur scène avec un t-shirt à l’effigie de Manson, ou en entretenant une sorte de fascination morbide pour celui qui se présentait volontiers comme un paria de la société.
À lire Charles Manson par lui-même, on comprend certes que Manson a conscience d’être un voleur minable, un musicien raté et un addict, mais on voit surtout qu’il prétend être un apôtre de l’amour qui tiendrait finalement plus du «martyr révolutionnaire que du tueur endurci». «Don’t Do Anything Illegal», chantait-il sur l’un de ses morceaux les plus souvent cités. L’un des plus incarnés également. Le bon sens aurait voulu qu’il suive lui-même ses conseils.
We would love to say thanks to the author of this post for this remarkable material
Charles Manson, une histoire de drogues, de meurtres et de folk-songs
Check out our social media accounts and also other related pageshttps://nimblespirit.com/related-pages/