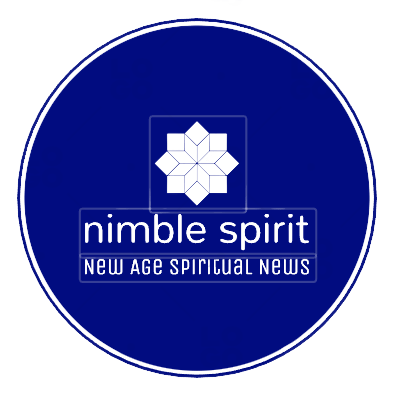DANS LES ARCHIVES DE “TÉLÉRAMA” – Il y a cent ans, le 9 novembre 1922, naissait Raymond Devos, clown-philosophe virtuose du non-sens. En 1993, il nous racontait sa version de l’humour. Une interview qui devrait être remboursée par la Sécu…
On l’a vu, au fil des ans, plonger dans la quatrième dimension, se fondre dans l’antimatière et même visiter la Lune. Grâce à lui, on a vu, de nos yeux vu, des anges (qui passent) et des doutes (qui planent). Mieux : on a même pu observer le silence, l’espace d’une minute. Au-delà des mots, avec lesquels il joue toujours en virtuose, Raymond Devos propose chaque soir à nos raisons étriquées de plonger dans la sagesse de sa folie. Clown-philosophe, il voyage dans l’imaginaire pour mieux croquer la réalité. En tendant un miroir surréaliste à nos difficultés existentielles (Dieu, la mort, la faim dans le monde, la sexualité, etc.), il sème le doute et récolté le rire.
Un sketch de Devos, c’est toujours un mystère. On n’arrive pas à comprendre comment ça fonctionne, comment c’est construit. On a envie d’entrer dans votre cuisine, dans votre laboratoire et de vous demander comment vous inventez, comment vous écrivez…
En faisant du surplace ! Il me faut un déclic, une ouverture. Un prétexte assez solide pour me donner envie d’aller à l’aventure. C’est, hélas, toujours laborieux. À partir d’une idée, j’explore toutes les directions. Parfois, il y a une porte qui s’ouvre et je m’y engouffre. Parfois aussi, c’est la chute que je trouve d’abord. Et je marche à reculons !
Un sketch peut naître d’un mot, d’une situation ou d’une musique. [Devos se met au piano, joue quelques notes de Caravan, de Duke Ellington.] Vous voyez, avec cette musique, l’imaginaire de chacun fonctionne. On voit le désert.
Du coup, je suis en train de travailler sur un texte où je ferais la traversée du désert dans l’imaginaire (ce qui réduit les frais de voyage !) J’emmènerais une valise avec du sable. Comme ça, si je suis fatigué, je pourrai lâcher du lest ! J’ai déjà le début (le morceau de musique) et la chute (mais chut, c’est une surprise !). Il me reste à fignoler la courbe intérieure. En me méfiant, surtout, de l’habileté que j’ai peu à peu acquise. Elle m’offre des garanties que je refuse. Ce qui m’excite, c’est le risque.
L’autre écueil, c’est qu’un détail, un minuscule détail, tue la cohérence de l’ensemble. Le poète peut se permettre une petite faute, dans les vibrations ou les couleurs. Il peut même flirter avec le mauvais goût, ça passe. Le comique, lui, doit travailler avec une rigueur mécanique, presque scientifique.
Concrètement, ça se passe comment ?
J’essaie de partir d’une situation banale (« Je me promenais dans la rue, je tenais mon chien en laisse. Je rencontre une dame qui demande à sa petite fille d’aller caresser le chien… »). Dans ce quotidien banal, j’introduis une petite absurdité. Doucement (« La petite fille est venue me caresser la main »). Ça y est, la mécanique est en route, je peux aller plus loin (« J’avais beau lui dire qu’il y avait erreur sur la personne, la petite fille continuait à me caresser. La dame lui a dit : “Tu vois bien qu’il n’est pas méchant.” ») Là, on décolle, puisqu’il y a même un témoin qui confirme la scène. On peut continuer (« Mon chien, qui ne rate jamais une occasion de se taire, a dit : “Il ne lui manque que la parole, madame” »). Tout a basculé.
Et le spectateur vous suit…
Oui, parce qu’il est troublé. Comme lorsque je m’interroge pour savoir à quoi pense le Penseur de Rodin. Pour moi, c’est un défi. Ça naît d’une rêverie et ça permet de s’interroger sur l’âme des objets inanimés. Est-ce que la pensée du Penseur ne reflète pas celle du génial sculpteur qui a dû la lui enfoncer dans le crâne à grands coups de maillet ? Ça, c’est le trouble. Je ne me suis jamais dit : « Il faut que j’écrive un truc sur le Penseur de Rodin ». Jamais. C’est venu comme un jeu.
“Le jeu de l’esprit ne m’intéresse que lorsqu’il est au service du malentendu.”
Et ça vous permet d’aborder, mine de rien, toutes les questions métaphysiques… L’infini, par exemple, avec “Le Bout d’un bout”.
Ça, c’est un texte que j’ai repris récemment et qui marche comme au premier jour. Parce que c’est le raisonnement absolu : un bout, ça a toujours deux bouts. C’est incontestable. Vous pouvez prendre un bout par n’importe quel bout, il y a toujours deux bouts. Et vous pouvez prendre mon raisonnement par tous les bouts, il se tient ! Vous pouvez toujours casser un bout de bois en petits bouts de bois, il y a toujours deux bouts à chaque bout. C’est infaillible. Et infini !
On a le sentiment cependant que vous jouez de moins en moins avec les mots…
Les mots sont toujours là pour épauler le récit. Quand on en trouve un qui a un double sens. c’est formidable. C’est le grand secret. Le langage, c’est quand même l’expression la plus intelligente de la pensée ! Mais le jeu de l’esprit ne m’intéresse que lorsqu’il est au service du malentendu. C’est pour ça que ça m’agace quand on me parle seulement de mes jeux de mots. Je me sers d’eux, bien sûr, mais si on ne décelait pas ce qu’il y a derrière, je serais peiné.
“Le comique naît de l’abolition de la censure logique. Pour la vaincre, il faut la piéger par une incongruité.”
Votre force, c’est aussi, paradoxalement, la simplicité de votre vocabulaire.
Il n’y a pas un mot savant dans mes textes. Il y a pourtant des mots qui m’enchantent. Mais si je les utilise, si les gens doivent faire un effort pour les comprendre, c’est fini. Ils vont se réveiller.
J’essaie de proposer des ambiances qui restent dans les esprits. De déclencher des images. De proposer un voyage de l’autre côté du miroir. Presque à l’insu des spectateurs. Si mon raisonnement résonne, il vit. Mais si je durcis le trait, ça frappe mais ça ne vibre plus. C’est Cocteau qui disait que lorsqu’on trace un trait, il peut être vivant ou mort. C’est mystérieux, tout ça. Mystérieux mais essentiel.
Comment définiriez-vous votre comique ?
Alors là, attention, je vais être très technique ! Le comique naît de l’abolition de la censure logique. Pour vaincre la censure logique, il faut la piéger. Comment ? Par une incongruité. L’irréalité rentre alors subrepticement dans la conscience et illumine le réel, ce qui fait qu’on l’oublie. Du coup, l’énergie qui est en chacun de nous, débarrassée de la tension du réel, s’élimine en faisant vibrer les muscles les plus vulnérables que sont les zygomatiques. Réaction qui est anti-logique, anti-réel. Finalement, le rire, c’est une erreur ! Une erreur utile, parce que la nature a dû se dire que c’était nécessaire à notre survie.
Il y a un certain nombre de thèmes que vous osez désormais aborder : la sexualité, par exemple.
C’est peut-être parce que je joue de moins en moins des personnages. Quand j’étais comédien, au début, ça ne m’amusait pas vraiment d’être dans la peau d’un autre. Moi, tout ce que je dis, c’est le reflet de ce que je suis. De mes soucis. De mes agacements. De mes rêves. Mais, quand je me raconte, j’ai vraiment le sentiment de raconter les autres. Parce que j’aborde les questions qui nous préoccupent tous : le mensonge, la dissimulation, les complexes… Dans son subconscient, chacun réfléchit à tout ça. Les sentiments, la sensualité, la sexualité, ça fait partie de l’aventure humaine.
“C’est quand on croit qu’on peut tout expliquer, quand on a perdu toute innocence que vient le désespoir.”
Souvent, c’est seulement dans les rêves qu’on aborde ça. Parce que le rêve, c’est l’abolition de la censure morale. C’est là qu’on peut découvrir certaines de nos tendances sans en avoir honte, alors que, dans la réalité, on chasse ces images dès qu’elles arrivent. Le rêve, c’est un exutoire formidable. On se parle peu à soi-même de ses conflits intimes. On joue les sages, les raisonnables. Mais si on veut toucher des vérités, il faut sortir de la raison.
Et retrouver la grande vertu de l’innocence…
Ah ! Vous employez le mot qu’il faut. Parce que notre innocence est terriblement menacée, par la conscience. Nous sommes tentés de censurer nos illuminations, d’éviter notre regard intérieur. La sensualité, l’expression de nos désirs, ce peut être bestial. Il y a des gens qui tuent pour ça, pour des coups de passion. Et, en même temps, c’est l’un des pôles essentiels de l’aventure humaine ! C’est quand on croit qu’on peut tout expliquer, quand on a perdu toute innocence que vient le désespoir.
Ça vous arrive ?
Oh oui !
Et vous vous en sortez comment ?
Je vais vous faire une confidence. Depuis mon accident cardiaque, j’ai parfois des moments de stress face à la réalité. Avant, je ne savais pas ce que c’était, ce stress. Quand ça m’arrive, il faut que je sorte de moi-même. Alors, je dis mes textes tout seul. En allemand.
En allemand ?
En allemand, parce que là, j’oublie tout.
Beaucoup d’universitaires se sont intéressés à votre travail. Cela vous touche ?
Quelquefois, c’est très technique. Très sec. Mais quand c’est fait par quelqu’un de sensible, c’est formidable. Il y a une Canadienne qui m’a beaucoup appris sur moi-même ! Elle s’occupe des handicapés mentaux, des troubles du langage. Je suis très intéressé par les gens qui oublient ce qu’ils viennent de dire…
Vous avez des handicaps, vous ?
Si je me suis intéressé au langage, c’est que j’avais beaucoup de mal à m’exprimer. Je ne bégayais pas, mais je n’osais pas parler. Je ne savais pas demander. Je ne savais pas réciter, même une fable de La Fontaine.
Maintenant, vous osez presque tout. Vous transformez en peigne, en pied de vigne, en statue… Et pourtant, vous gardez, sur scène, une certaine pudeur…
Ça, c’est une affaire de respect d’autrui. Parce que je respecte mon prochain, je refuse cette espèce de mépris…
… Qu’il y a chez certains comiques ?
Auparavant, les chansonniers ne disaient pas que des choses intelligentes. Mais c’étaient des gens cultivés. Aujourd’hui, il y a des petits cons (pardon d’être vulgaire !) qui se permettent d’insulter des gens qui leur sont nettement supérieurs.
Il y a un comique qui enfonce le clou là où vous, vous suggérez…
Je n’aime pas trop parler de ça. Si on enlève la pudeur, qu’est-ce qui reste ? Pour dévaloriser les valeurs, il faut avoir, justement, le sens des valeurs. Connaître la valeur des choses, la valeur des sentiments. Les respecter. Si on ne respecte pas l’homme, avec ses défauts et ses qualités, c’est foutu, c’est fini. C’est une question de nature.
“Je peux avoir des échanges avec le public. Avant, c’était la harangue, j’allais le chercher. Disons qu’il y a une certaine connivence qu’il a fallu mériter.”
Votre nature, c’est d’avoir confiance en l’homme ?
L’homme m’émerveille. Je suis comme un gosse, toujours étonné. Je ne comprends pas qu’on puisse dire, comme certains : « C’est un connard, c’est un connard. » Il y en a même qui, pour faire rire, montrent leur cul. On ne leur en demande pas tant. Il y a des choses qu’il faut cacher. Pas par hypocrisie, mais par pudeur.
À côté du texte, l’interprétation joue un rôle capital. Il y a des sketches, comme “J’ai des doutes”, que vous dites très différemment maintenant…
Parce que je les jouais mal il y a vingt ans. Aujourd’hui, je sais mieux quand je joue juste. Mais je ne réfléchis pas trop. C’est moi qui ai inventé ces textes. Je rentre dans le rêve. Je sais ce qui doit être dit et surtout ressenti.
Vous jouez plus qu’avant avec le public.
Parce qu’il m’a accepté. Je peux avoir des échanges avec lui. Avant, c’était la harangue, j’allais le chercher. Disons qu’il y a une certaine connivence qu’il a fallu mériter.
C’est pour ça que vous n’aimez guère la télé ?
J’en fais quand même, mais le moins possible. Parce que c’est difficile de séduire un public qui n’existe pas. Vous croyez dire une chose intéressante et, pendant ce temps-là, il y a quelqu’un dans la famille qui demande à changer de chaîne !
Votre rentrée parisienne vous fait peur ?
J’ai eu peur quand je l’ai décidée, oui. Maintenant, ça va. Le soir où je commencerai, c’est sûr, j’aurai le trac. Mais ce sera un trac très raisonnable. Je n’ai pas honte de faire ce que je fais et je n’ai pas à en avoir peur. Disons que j’ai honte d’avoir peur ! J’ai surtout la crainte d’avoir une défaillance, une déficience. De ne pas rentrer dans le jeu, de ne pas m’oublier comme il faudrait.
“Un jour, j’ai dit : ‘Mesdames et messieurs, je vais vous faire apparaître Dieu !’ C’est pas le tout de le dire. Il faut le faire.”
Un nouveau texte, c’est difficile à porter sur scène ?
Quand vous dites un sketch pour la première fois, c’est un peu comme si vous tentiez un triple saut périlleux alors que vous ne faisiez que des doubles sauts. Et encore ! Le triple saut périlleux, même raté, ça reste un exploit. Peut-être même surtout si vous le ratez ! Mais dans un spectacle, si les gens ne rient pas, ce que vous dites n’a plus aucun sens.
Ça vous est arrivé ?
Oui, et même avec des textes qui ont marché par la suite. Mais il y a aussi des moments de pur bonheur. Un jour, les gens étaient tellement heureux à la fin du spectacle que j’ai voulu leur faire plaisir. J’ai fait un coup de bluff. Et j’ai dit : « Mesdames et messieurs, je vais vous faire apparaître Dieu ! » C’est pas le tout de le dire. Il faut le faire, justifier la phrase qu’on a jetée, comme ça, par défi. D’ailleurs, les difficultés ont commencé quand j’ai voulu le faire disparaître. Il ne voulait pas !… J’aime bien ça. L’improvisation. Le partage de l’imaginaire, quand c’est aussi fou, c’est la récompense suprême.
Vous parlez beaucoup de Dieu dans le spectacle.
Comment voulez-vous l’ignorer ! Dès qu’on aborde l’idée de Dieu, il y a l’idée de la mort. Toute notre existence est fondée là-dessus. L’homme peut se pencher sur son passé, vivre le présent et se projeter dans l’avenir. Et l’avenir, c’est quoi ? L’avenir, c’est la mort. Il faut bien arriver à le dire, quand même ! On va finir par mourir. On n’y croit pas beaucoup. On croit que ça n’arrive qu’aux autres. Mais quand même, cette idée-là est en nous, tout le temps. Il faut constamment s’en défaire. Le comique permet seulement de supporter cette idée.
Avant la mort, il y a parfois la dégradation physique. Votre spectacle s’ouvre sur ce thème, avec un sketch irrésistiblement drôle. Et irrésistiblement douloureux, puisque vous vous rapetissez jusqu’à ramper…
Je suis parti d’une idée qui nous concerne tous. À partir d’un certain âge, on est obligé de se surveiller. Dès qu’on a un moment de distraction, on n’est plus tout à fait droit ! On a tous tendance à se remettre à quatre pattes ! Si on se relâche, tout s’effondre. J’ai simplement poussé la logique du dérèglement physique.
Et vous faites même vos adieux anticipés !
Oui, nous sommes en 2003 et je fais la répétition de mes adieux. Le plus difficile, c’est de réussir le dernier soupir. Je suis obligé de m’y reprendre à plusieurs fois !
Alors que vous, vous ne me paraissez pas vieillir dans la réalité…
J’allais presque vous répondre : « Je n’ai pas le sentiment d’avoir vécu ! » C’est quand même exagéré. Mais il y a du vrai. À force d’avoir un pied-à-terre dans l’imaginaire, j’ai un peu perdu pied avec le réel.
Malgré les soucis quotidiens ?
Ça, c’est l’épouvante ! Je ne suis pas fait pour ça. Je n’ai aucun courage devant la vie. Je préfère dire mes textes… en allemand ! Il y a cette phrase de De Gaulle : « La vieillesse est un naufrage. » Quand même, il savait de quoi il parlait. Moi, je vais avoir 71 ans. Je prolonge le
plus possible. Simplement le fait d’exister. Je suis le doyen des comiques. Mais j’ai à peu près toutes mes facultés. Pour le reste, je triche…
Vous trichez plutôt bien…
Vous voulez dire que je triche très bien. Faire ce que je fais à mon âge, c’est le propre de la tricherie réussie, non ?
Article paru dans le Télérama n° 2280 du 22 septembre 1993
We wish to thank the author of this post for this outstanding material
Raymond Devos en 1993 dans “Télérama” : “Quand je stresse, je dis mes textes tout seul. En allemand”
Check out our social media profiles and other related pageshttps://nimblespirit.com/related-pages/