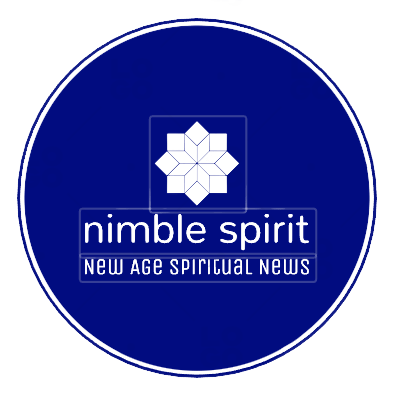Pour les amateurs de jazz, qui dit rentrée des classes dit Jazz à La Villette. Pendant une dizaine de jours, le festival parisien prend ses quartiers dans le Parc du même nom, magnifique écrin de verdure au cœur du 19ème arrondissement de la capitale. Au programme de cette 20ème édition : pointures internationales (les Américains sont d’ailleurs de retour après deux années perturbées par le Covid) et découvertes (notamment grâce à la programmation éclectique et aventureuse d’Under the Radar).
Dimanche 4 septembre – 16 h. Paris 19, Cité de la Musique
Il fait beau sur Paris. En ce premier dimanche de septembre, les pelouses du Parc de la Villette grouillent de monde. Vélos, poussettes et trottinettes encombrent les allées. Il y a foule devant l’entrée de la Cité de la Musique. De nombreux enfants s’agitent dans le hall. Le concert est à 16 h : l’occasion d’y venir en famille. Au programme : le projet Asynchrone, imaginé par le violoncelliste Clément Petit et le pianiste Frédéric Soulard autour de la musique du compositeur japonais Ryuchi Sakamoto, puis la première de Dress Code, spectacle musical réunissant entre autres, le flûtiste Joce Mienniel et le pianiste Christophe Chassol. Alléchant.
Le concert d’Asynchrone commence dans un murmure. Celui des paroles d’une femme dans une langue qu’on jurerait japonaise. Puis le silence. Manuel Peskine entame un ostinato au piano, rejoint par la batterie millimétrée de Vincent Taeger. Les deux leaders les rejoignent instillant un climat hypnotique à grand renfort d’électronique. Delphine Joussein et Hugues Mayot entrent alors dans la danse, soufflant le thème à l’unisson. On est déjà aux anges. Ça monte et ça descend. C’est puissant et méditatif à la fois, solaire et répétitif, énigmatique et pulsatile. Le reste du concert ne démentira pas une seule seconde ce choc initial. L’utilisation conjointe d’instruments acoustiques et électriques ainsi que l’assise rythmique métronomique, pulsée par Vincent Taeger et Clément Petit notamment, constituent les fondements de la musique d’Asynchrone. Et que dire de l’association entre la flûte foutraque et branchée de Joussein et le son chaud et épais du saxophone (ou de la clarinette basse sur quelques morceaux) d’Hugues Mayot ; ces deux-là s’entendent à merveille et nous font décoller à chacune de leurs interventions. Le public ne s’y trompe pas et réserve à Asynchrone un très bel accueil. Le groupe vient de sortir un EP baptisé Kling Klang chez No Format. On attend l’album avec beaucoup d’impatience.
Après un long changement de plateau, la soirée continue avec le programme Dress Code. Joce Mienniel trône au centre de la scène. Chassol et ses claviers à sa droite. Le batteur Mathieu Edouard à sa gauche. Un fauteuil club rouge pétard traîne sur le devant de la scène. Le décor est minimaliste. Un écran dans le fond diffuse des images en clair-obscur, floues et détourées. Couleurs pastel. Impressions graphiques. Mike Ladd, costume sombre sur une chemise saumon, arpente la scène tel un boxeur enragé. Mienniel, en résidence depuis trois ans à l’Abbaye de Royaumont, a imaginé ce spectacle comme la bande originale d’un film imaginaire. Dress Code est une dystopie écrite par Amaury Chardeau, qui se déroule le temps d’une étrange soirée, dans une maison au bord de la mer. On y suit une femme qui erre dans cette fête comme un fantôme, un peu égarée. Le texte est dit par la belle voix grave de Tania de Montaigne. Théâtre musical ? Concert théâtralisé ? Un peu des deux mais pas que. Plutôt un spectacle hybride et singulier qui mêle tous les langages dans un grand tout jubilatoire. D’abord perplexe, on se laisse très vite emporter par l’histoire, le rythme et la narration. La scénographie très légère permet de s’immerger totalement dans la musique. Une musique chaleureuse, dense et sensuelle qui convoque Moondog, Nirvana, Chopin ou Hendrix. Une musique mise en mouvement par quatre incroyables musiciens dont on jurerait qu’ils jouent ensemble depuis des années, tellement leur association nous semble une évidence. Une musique touchante et hétéroclite, parfois naïve, mais dont la tendresse et la sincérité emportent définitivement l’adhésion.

- Joce Mienniel – Christophe Charpenel
Lundi 5 septembre – 20 h 30. Pantin, La Dynamo
Toute la journée, il a fait chaud et lourd sur Pantin, le ciel se faisant de plus en plus menaçant au fil des heures. Quelques minutes avant le concert, un violent orage éclate. Des trombes d’eau puis le silence. La pluie s’arrête net, nous laissant juste le temps de rejoindre la Dynamo, à peine mouillé par quelques gouttes retardataires. Ce soir c’est l’Orchestre 2035 qui régale. En filant la métaphore météorologique, nous pourrions comparer la musique de l’orchestre à un orage d’été. Violent et soudain. Bref et déchaîné. Bouchons d’oreilles recommandés ! Encagoulés dans des masques DIY, tous plus bizarres les uns que les autres, les quatorze musiciens entrent et s’installent. Batteries, percussions, basses et guitare électriques, tuba, vibraphone, Rhodes, clarinettes, saxophones et trompette. Inventaire à la Prévert. Joyeux capharnaüm. La scène semble trop petite pour contenir un tel instrumentarium. Un saxophone ténor entame un riff lancinant. Cinq notes. Répétées ad nauseam. Tous les regards sont braqués sur lui. Nos oreilles également. Solitude du soliste. Compassion. Pendant un temps (trois minutes, quatre, peut-être plus) qui paraît une éternité il enchaîne ses notes, il s’accroche. Jusqu’à ce que l’orchestre se mette en branle comme un seul homme (ou une seule femme, après tout) et le rejoigne dans une transe frénétique. C’est brutal comme une déflagration, comme une énorme claque qui vous arrive alors que vous regardiez ailleurs. Sonné, on reprend ses esprits tant bien que mal. On s’accroche à notre tour, bousculé par ce mur de sons. La musique progresse inexorablement. Par micro-variations. Ça monte et ça descend ; la musique se cabre, ralentit, se décale, repart de plus belle, aiguillée à tour de rôle par chacun des musiciens. C’est répétitif et dansant, éruptif et foutraque, rythmé et grisant. L’orchestre dégage une aura et une énergie incroyables. Bref : un concert que l’on n’est pas près d’oublier.
Mercredi 7 septembre – 20 h. Paris 19, Cité de la Musique
Il est 20 heures. D’un pas lent, Cheick Tidiane Seck monte sur scène dans une belle tenue traditionnelle d’un noir éclatant, lunettes de soleil sur le nez. Sur sa tête, une coiffe marron. Il est seul. S’assoit au piano. On entend une mouche voler. Il prend son temps, s’étire, dépose sa coiffe sur son épaule, respire. Puis se lance. Cinquante minutes de recueillement. Le répertoire est celui de son premier (à bientôt 70 ans !) album solo Kelena Fôly, sorti en fin d’année dernière. L’ambiance est feutrée et intimiste, lumières tamisées braquées sur le Steinway. Simple et sobre. Le moment est toutefois quelque peu gâché par les nombreuses allées et venues (tout au long du concert) de spectateurs retardataires accrochés à l’écran lumineux de leur téléphone. Mais passons. Les morceaux s’enchaînent, les influences s’entremêlent : un hommage à Césaire, plusieurs blues, un traditionnel malien et puis « Motherless Child », spiritual arrangé par le pianiste dans une version très personnelle. Cheick Tidiane Seck semble appeler à l’unité des hommes et de la nature. Nous exhorte à préférer l’esprit des choses plutôt que les choses de l’esprit. Musique de l’âme. Musiques des âmes. Fier et souriant, il clôture son récital les mains jointes en prière à hauteur du cœur, saluant un public acquis à sa cause.
Puis c’est au tour d’Angel Bat Dawid et de son groupe Tha Brothahood de monter sur scène. Étincelante dans une robe rouge vif du plus bel effet, chevelure tressée de perles en bois marrons et jaunes, rehaussée de mèches bleu clair, énormes lunettes rondes aux reflets rouges, la maîtresse de cérémonie avance vers le centre de la scène pour prendre possession de son attirail, clarinette bien sûr, claviers évidemment, mais également percussions, mélodica et autres objets mystérieux. Derrière elle, un écran diffuse des images évoquant le sort des populations afro américaines aux Etats-Unis. Le set débute alors, épique et sauvage. Dès le premier morceau, elle demande aux spectateurs de se rapprocher de la scène et de venir communier avec elle (voir cela dans la très classieuse salle des concerts de la Cité de la Musique est un spectacle à lui tout seul). Tout au long du concert se glissent des hommages plus ou moins appuyés à des musiciens qui l’ont inspirée : Yusef Lateef, Pharoah Sanders (« The Creator Has a Masterplan ») ou Bob Marley (« War »). Sa musique, à la fois spirituelle et engagée, Angel Bat Dawid la cultive avec une certaine démesure, un peu à l’image d’un Sun Ra. Elle alterne entre ses instruments, chante, se lève, se rassoit, gesticule, harangue la foule, crie, murmure, parle aussi. Beaucoup, sans doute trop. C’est brouillon et parfois un peu convenu. On reste du coup sur notre faim, avec un goût d’inachevé dans la bouche. Le public lui réserve pourtant une ovation.

- Maya Dunietz – Christophe Charpenel
Vendredi 9 septembre – 20 h. Paris 19, Cité de la Musique
En ce dernier weekend de festival, c’est dans une Cité de la Musique pleine à craquer que je prends place pour un des concerts phares de cette édition 2022, celui du quartet d’Avishai Cohen. Mais si la venue du trompettiste israélien constitue sans aucun doute un événement, la présence de Maya Dunietz en première partie en est un également, car la pianiste a fait beaucoup parler d’elle ces derniers temps. Elle se présente en trio avec le contrebassiste Barak Mori et le batteur Amir Bresler. Piano/contrebasse/batterie, soit la formation-étalon d’un jazz quelque peu suranné que la pianiste israélienne dépoussière avec vigueur et talent. Très excitée à l’idée de faire la première partie d’un de ses héros, Dunietz introduit chaque morceau avec naturel, balançant quelques traits d’humour toujours bien sentis. Le concert alterne morceaux de son premier album Free The Dolphin et nouvelles compositions. Mon voisin gigote, semble s’ennuyer. Sa fiancée tente de le réconforter comme elle peut. L’entente entre les trois musiciens est pourtant totale. Le style atypique et facétieux de la pianiste semble être la synthèse d’esthétiques fort différentes (jazz, musique africaine, folklore juif). Il allie fraîcheur et intensité, fougue et retenue, comme une rencontre improbable entre le feu et la glace. Le public ne s’y trompe pas et réserve un très bel accueil au trio. Après de longs applaudissements, Maya Dunietz tient à souligner la qualité d’écoute de la salle. Elle quitte la scène radieuse.
Avishai Cohen et son quartet composé de Yonathan Avishai au piano, de Barak Mori à la contrebasse et de Ziv Ravitz à la batterie, prennent le relais. Les quatre musiciens sont installés très près les uns des autres, aménageant un espace dans lequel ils pourraient presque se toucher. La musique y circule librement, le silence aussi. Cette proximité s’entend dès les premières notes de l’inaugural duo contrebasse/batterie, où l’expressivité de la trompette du leader se dilue dans le jeu très ramassé de Mori. L’osmose est visuelle autant qu’auditive. Le groupe débute son concert par « Naked Truth », suite en huit mouvements gravée sur l’album du même nom sorti chez ECM l’année dernière. 35 minutes de pur bonheur et d’intense méditation. Le public retient son souffle, happé par celui, lyrique et hypnotique, du trompettiste. Cohen clôt cette première partie par la récitation d’un poème de Zelda Schneurson Mishkovsky, poètesse juive née en 1914 en Ukraine, sur la vie, la mort et le renoncement. Le groupe continue avec d’anciennes compositions. « Will I Die, Miss ? Will I Die, Miss ? » est un morceau inspiré par la guerre en Syrie. La narration y est limpide. Superbement soutenue par le duo Mori/Ravitz, la trompette du leader furète au milieu des accords lancinants de Yonathan Avishai. Celui-ci, véritable pierre angulaire du quartet, illuminera tout le concert de son jeu souple et liquide. Puis c’est le morceau « Into The Silence » (issu de l’album du même nom) qui est convoqué, dans lequel Ziv Ravitz nous gratifie d’un solo à la fois démonstratif et plein d’émotion. Le public est envoûté, sous le charme. Il applaudit à tout rompre. Reste pourtant un merveilleux rappel : « Quiescence », suave et sensible, qui clôture magnifiquement le concert sur une ritournelle légère et aérienne, une brise de fin d’été.

- Avishai Cohen – Michel Laborde
Dimanche 11 septembre – 16 h. Paris 19, Philharmonie
Point d’orgue de cette 20è édition du festival Jazz à la Villette, l’affiche du dernier dimanche avait fière allure : elle réunissait le projet Louise d’Emile Parisien puis Cosmic Music : A Contemporary Exploration of the Music of John & Alice Coltrane, l’hommage de Ravi Coltrane à ses parents. Le saxophone au cœur.
Émile Parisien est ému. Heureux et ému. Après les honneurs des plus grands festivals estivaux, il a aujourd’hui ceux de la Philharmonie de Paris. Et en première partie de Ravi Coltrane, fils d’une de ses idoles de jeunesse. Le symbole est immense. Consécration. Qu’il semble loin le temps des premières scènes estivales gersoises qu’il arpentait, catogan au vent et saxophone en bandoulière, avec son quintet Ephémère. Ascenseur social du jazz. Parisien a bien grandi depuis et nous avec. Il est aujourd’hui à la tête d’un sextet de haut vol réunissant fidèles musiciens amis (Roberto Negro et Manu Codjia) et vedettes américaines (Joe Martin, Theo Crocker et Nasheet Waits). A la Philharmonie, Parisien est chez lui. Il sait recevoir. Il présente avec gourmandise ses musiciens. Le collectif avant tout. À chaque morceau, il clame leur nom comme pour se rappeler avec quels musiciens géniaux il joue aujourd’hui. Il donne l’impression de ne pas en revenir, comme émerveillé par ce qui lui arrive. Sourire aux lèvres, il déambule sur la scène, échange mots et sourires avec chacun, se délectant, agenouillé comme en prière, de chacune des interventions de ses camarades de jeu. Car pour Émile, la musique est un jeu où l’énergie, la spontanéité, le partage et le plaisir seraient les quatre éléments fondateurs.
Le répertoire du concert est celui de leur album Louise, sorti chez ACT en janvier dernier. D’abord « Louise », introduit par un solo très expressionniste du saxophoniste, bâti sur des arpèges sibyllins de Manu Codjia ; puis « Jojo », l’hommage à Joachim Kühn, où la fougue et l’exubérance du saxophoniste tranchent avec le calme et la sérénité de Théo Croker, révélant une relation en clair-obscur. « Memento » ensuite, autre hommage, à la mère d’Émile celui-là, où Roberto Negro se lâche dans un solo démentiel et possédé qu’il terminera essoufflé et groggy, semblant se demander ce qu’il venait d’advenir. Puis c’est au tour de Joe Martin d’y aller de son solo pour introduire la très belle composition de Roberto Negro « Il Giorno de la civetta », un solo majuscule d’une grande sensibilité. Et enfin « Madagascar », un morceau de Joe Zawinul période Weather Report, un des modèles de Parisien, où c’est au tour de Nasheet Waits de nous proposer un solo dantesque d’une précision et d’une musicalité diaboliques. Applaudissements nourris et chaleureux. Le public est repu.

- Emile Parisien « Louise » – Gérard Boisnel
Le changement de plateau traîne en longueur. Le public s’impatiente. Plusieurs salves d’applaudissements. En vain : Ravi Coltrane se fait attendre. 17 h 40 : il entre enfin, accompagné de son quartet. Après un puissant solo de batterie, Elé Howell lance le tempo mais Ravi ne semble pas prêt ; il gesticule, cherche quelque chose sur son téléphone ; Gadi Lehavi brode au clavier. Quand le saxophoniste embouche enfin son ténor, c’est pour esquisser un semblant de thème puis se lancer dans un long solo, ample et introspectif. Le ton est donné. Ce sera l’esprit plutôt que la lettre. Au lieu d’enchaîner les tubes de John et Alice, Ravi Coltrane a choisi de tourner autour de la musique de ses parents, alternant compositions spécialement écrites pour l’occasion et morceaux moins connus. Le groupe semble se chercher, comme s’il avançait à tâtons dans l’inconnu. Elé Howell et Gadi Lehavi font le job, bien présents, à l’écoute. C’est plutôt le contrebassiste Rashaan Carter qui semble un peu en-dedans, comme à contre-temps, tout comme son leader, lunaire, sans doute impressionné par l’événement et par l’aura gigantesque de ces parents sacrés. Au fur et à mesure du concert, la sauce prend tout de même. Les instruments se délient, le groupe se resserre. Coltrane alterne les saxophones (ténor, soprano et sopranino) mélangeant les couleurs et variant les ambiances, idéalement soutenu par le jeu souple et affirmé du jeune Elé Howell et par le toucher et la musicalité de Gadi Lehavi. Malgré tout, on reste quelque peu sur notre faim jusqu’au rappel. On reconnaît alors immédiatement « Alabama », thème mythique de John Coltrane, chargé d’histoire et de symboles. Culotté. Le public est debout. Le festival Jazz à la Villette touche à sa fin.
We wish to give thanks to the author of this post for this awesome web content
Jazz à la Villette, le beau temps
Discover our social media profiles , as well as other pages that are related to them.https://nimblespirit.com/related-pages/