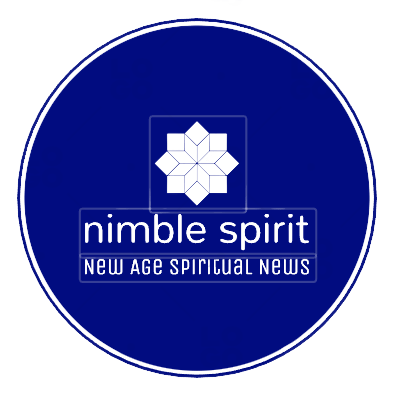« Le Mage du Kremlin », de Giuliano da Empoli (Gallimard)
C’est l’histoire d’un dramaturge d’avant-garde qui va se consacrer à faire, d’un obscur petit chef du FSB, le tsar de la Russie conquérante sur la scène de théâtre du monde. Vadim Baranov aime le rock, le rap, le cardinal de Retz, Stanislavski, Limonov, écrire des essais de polémologie sous pseudo et produire des émissions de télé-réalité « barbares et vulgaires ». Le jour où il le rencontre, dans un bureau de sous-fifre, Vladimir Poutine ne paie pas de mine. A ce « blond pâle aux traits décolorés, portant un costume en acrylique beige », Baranov, pour le convaincre de partir à l’assaut du Kremlin et d’incarner une autorité verticale dont le pays de ce soûlard d’Eltsine a besoin, lui donne comme modèle « une vieille actrice américaine », Greta Garbo. Pourquoi ? « Parce que l’idole qui se refuse renforce son pouvoir. Le mystère génère de l’énergie. La distance alimente la vénération. »
Ainsi cornaqué, Vladimir Poutine devient, au seuil du nouveau millénaire, le président de la Fédération de Russie et l’incarnation glaciale de sa devise : l’ordre à l’intérieur, la puissance à l’extérieur. Et il n’oublie pas ce qu’il doit à Vadim Baranov, de son vrai nom Vladislav Sourkov. Pendant quinze ans, le théoricien de la « démocratie souveraine », surnommé le « mage du Kremlin », fut l’inspirateur machiavélique, l’éminence grise, le statuaire, le spin doctor, voire le Raspoutine de Poutine le Terrible.
La suite après la publicité
Ce roman, dont certaines formules bien trempées rappellent les moralistes et mémorialistes français du XVIIe siècle, Giuliano da Empoli l’a terminé en janvier 2021, un an avant l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe. Certains diront que cet écrivain est visionnaire, d’autres qu’il connaît mieux que personne son sujet. Les deux qualités ne sont pas incompatibles. Ajoutons une troisième, le style, et on tient là un grand livre.
Dans la tête de Vladimir Poutine avec Giuliano da Empoli
« Les Presque Sœurs », de Cloé Korman (Seuil)
Mireille, Jacqueline et Henriette Korman sont les aïeules de Cloé Korman. Mais tout au long du magnifique récit qu’elle leur consacre, l’écrivaine inverse la généalogie et les appelle tendrement ses « petites-cousines ». Petites, Mireille, Jacqueline et Henriette le sont restées à jamais, assassinées à Auschwitz en juillet 1944, alors qu’elles avaient respectivement 12, 7 et 5 ans. Leurs parents, Lysora et Chava, ont été arrêtés deux ans plus tôt. Envoyés immédiatement à la mort.
Entre 1942 et 1944, les fillettes furent ballottées de camps en foyers, parfois ensemble, parfois séparées, au gré des atermoiements de l’Etat collaborationniste français « sur les catégories d’âge qui méritent ou non de vivre ». A leurs côtés, du moins pour un temps, se trouvaient Andrée, Jeanne et Rose Kaminsky, leurs voisines de Montargis, elles aussi filles d’immigrés juifs polonais, à peu près du même âge. Des « presque sœurs » qui, elles, ont survécu.
Cloé Korman sur les traces de ses « petites-cousines » mortes à Auschwitz
« Le Cœur ne cède pas », de Grégoire Bouillier (Flammarion)
Le nouveau livre de Grégoire Bouillier ressemble à un Jaenada : exhumation d’un fait divers oublié, reconstitution obsessionnelle de l’affaire, hypothèses examinées avec des prudences de légiste, digressions compulsives et, à l’arrivée, un livre bien trop lourd pour un honnête sac à main. Mais le travail de Grégoire Bouillier, lui, semble l’œuvre d’un esprit mélancolique.
La suite après la publicité
Dans cette histoire, il est question d’une certaine Marcelle Pichon, qui se trouva, à l’automne 1985, au cœur d’une actualité si effroyable que Daniel Bilalian lui-même, présentateur du journal d’Antenne 2, l’annonça à regret. Dans sa soixante-cinquième année, cette femme s’était laissée mourir de faim. On la découvrit des mois plus tard dans son minuscule appartement, au sixième étage d’un immeuble haussmannien de la rue Championnet (18e arrondissement de Paris). Près d’elle, dans un cahier d’écolier, étaient consignés les détails de son agonie. L’affaire fit grand bruit, d’autant que Marcelle avait été dans sa jeunesse un mannequin renommé de la maison Fath. On parla du désespoir des femmes seules. On blâma l’indifférence des voisins. On demanda où étaient les enfants. Et on n’en parla plus.
Grégoire Bouillier sur la piste d’une vieille dame qui s’est laissée mourir de faim
« Cher connard », de Virginie Despentes (Grasset)
Oscar Jayack a déconné. Ce romancier à succès a été « metooïsé » après la révélation d’une affaire de harcèlement remontant à ses débuts dans le métier. Désemparé, il décide de s’en prendre à la grande Rebecca Latté, actrice flamboyante et légendaire, « troisième de la Sainte Trinité » avec Béatrice Dalle et Lydia Lunch (mais elle emprunte aux deux). Quand, sur Instagram, Oscar la traite de « crapaud », Rebecca réplique avec la même brutalité : il est le « connard » du titre. Il s’avère que les deux routards de la notoriété ont grandi au même endroit « dont tout le monde se fout », quelque part en Lorraine, à l’ombre de l’usine Geiger. Deux transfuges de classe sans honte de leur extraction ni illusions sur leur milieu d’adoption.
Arrivés à ce stade, on se dit que ça va être simple. Oscar va gémir sur son sort, Rebecca le remettre à sa place et lui rappeler sa condition privilégiée de mâle blanc hétérosexuel. Mais « Cher connard » n’est pas plus binaire qu’il n’est un pensum féministe – même s’il absorbe en partie la substance de l’indépassable « King Kong Théorie ». On se lève et on se casse ? Non, on échange, on débat, on déballe, on étudie les fêlures de l’un et de l’autre. Penchant du côté de « Vernon Subutex », ce roman épistolaire dédié à Jean-Claude Fasquelle (directeur des Editions Grasset disparu l’an passé) dresse un portrait nuancé de deux cabossés de la vie, polytoxicomanes, seuls et enragés.
Avec « Cher Connard », Virginie Despentes écrit « les Liaisons dangereuses » post-MeToo
« Une Sortie honorable », Eric Vuillard (Actes Sud)
Vuillard s’en va-t-en guerre. Encore une fois. Après la Première Guerre mondiale (« la Bataille d’Occident »), après l’Anschluss dans « l’Ordre du jour », prix Goncourt 2017, l’écrivain s’intéresse à la guerre d’Indochine, dans « Une sortie honorable » (Actes Sud). Eric Vuillard ne se prend pas pour le Coppola d’ « Apocalypse Now ». Ce qui l’intéresse n’est pas le grand spectacle obscène des batailles, mais comme toujours, les coulisses, les tractations qui se jouent dans les salons feutrés, à l’Assemblée ou dans les conseils d’administration. C’est l’éternelle guerre des puissants contre les faibles que le romancier met en scène dans chacun de ses livres, avec une colère froide, méthodique et cette écriture si implacablement minutieuse. Dans cet entretien, il revient sur la colonisation, évoque Virginia Woolf et éclaire sa façon de travailler cette matière inflammable qu’est l’Histoire en la faisant entrer en résonance avec notre présent.
La suite après la publicité
Eric Vuillard : « Le soldat le plus inconnu est un Indochinois, un Arabe et un Noir »
« Les Abeilles grises », d’Andreï Kourkov (Liana Levi)
Traduit du russe par Paul Lequesne
En écrivant il y a deux ans « les Abeilles grises », que les Editions Liana Levi publient aujourd’hui, le plus célèbre écrivain ukrainien ne se doutait peut-être pas que sa ville de Kiev, où il est aujourd’hui retranché, serait sur le point de tomber aux mains d’un dictateur fou, d’un nostalgique de l’URSS et de la guerre froide. Son livre ne résonne pas moins de sinistre manière. Il se déroule dans la zone grise que se disputent, depuis 2014, séparatistes pro-russes et forces régulières placées sous l’autorité de Kiev. A perte de vue, ce ne sont que checkpoints et barbelés, casemates dissimulées sous une épaisse couche de neige, routes désolées sur un territoire en guerre.
Sergueïtch réside dans un village situé sur la ligne de front. Célibataire endurci, bon vivant, sympathique, il en est, avec Pachka, l’unique habitant. Les autres villageois ont fui les rigueurs de l’hiver et les coupures d’électricité, les tirs de snipers et les renvois d’ascenseur de l’artillerie adverse. Mais si Sergueïtch, apiculteur de son état, est fidèle à ses origines ukrainiennes, le cœur de Pachka penche, lui, pour les séparatistes. Du moins la vodka coule à flots. Avec trois verres dans le nez, l’heure est toujours à la réconciliation.
Andreï Kourkov, l’écrivain ukrainien qui défiait les Russes
« Journal de nage », de Chantal Thomas (Seuil)
Après le confinement, qui avait poussé à « l’hypocondrie et la paranoïa, blanchi la peau et ramolli les muscles », Chantal Thomas éprouva un besoin irrépressible de se jeter à l’eau pour se laver de la pandémie. Ce fut la Méditerranée, depuis la bien nommée baie des Anges. Et, aussitôt, l’extase. L’ivresse. La liberté. L’intemporalité : « Le corps qui nage n’a pas d’âge ni de poids ». Jour après jour, elle nota ses impressions, ses rêves amniotiques, ses souvenirs de la mère morte, les mille reflets du ciel sur les vagues, le charme exotique de la côte vue du large, l’amerrissage des mouettes (« nager rapproche des oiseaux »).
La suite après la publicité
Et quand elle sortait de l’eau verte, « couleur manteau d’huître », parfois calme et raisonnable, plus rarement agitée, c’était pour mieux plonger, sans masque ni tuba, dans la littérature masculine des maîtres-nageurs : Kafka, convaincu que « nager le libère de ses inhibitions », Patrick Deville, buvant la tasse dans les rouleaux du Pacifique, Paul Morand, dont la circumnavigation donne le vertige, et surtout Charles Sprawson, l’anthologiste, né à Karachi, de « Héros et nageurs ». Avec son histoire d’eau, Chantal Thomas, l’académicienne aux yeux bleu lagon, y ajoute la grâce féminine et voluptueuse de la nage indienne.
« Le corps qui nage n’a pas d’âge ni de poids » : Chantal Thomas se jette à l’eau
« Nom », de Constance Debré (Flammarion)
Tuer le père, Constance Debré laisse ça à Freud. De toute façon, son père à elle s’est tué tout seul, à petit feu, à doses d’opium puis d’héro. « Nom » s’ouvre sur sa mort. Récit clinique, gestes mécaniques. Un seau d’eau glacée balancé d’emblée à la tête du lecteur, histoire de le dégriser et de le préparer aux pages qui vont suivre, manuel de liquidation radicale, qui ferait passer « Extinction » de Thomas Bernhard, ce précipité de détestation littéraire, pour un traité sur le bonheur et le vivre-ensemble. Après avoir récusé l’hétérosexualité dans « Play boy », puis l’amour maternel dans « Love me tender », Constance Debré poursuit son entreprise de démolition des conventions bourgeoises et autres illusions qui entravent et enferment dans une « vie lamentable ».
Elle qui s’est déjà débarrassée de son métier d’avocate, des biens matériels, veut aujourd’hui en finir avec l’idée même de famille – le siège de la folie –, avec l’enfance, l’héritage. Avec tout ce qui leste et empêche de devenir soi. A commencer par ce nom, Debré, qui pèse si lourd. De l’inconvénient d’être bien née, en somme. Et d’avoir à porter ce patronyme qui contient rien de moins qu’une certaine idée de la France, de l’Etat.
Constance Debré, sans toit ni loi
« Quand tu écouteras cette chanson », de Lola Lafon (Stock)
Il fallait oser. Lola Lafon l’a fait. A l’été 2021, elle a passé une nuit là-même où, pendant vingt-cinq mois, Anne Frank a été cachée et cloîtrée avant d’être déportée à Bergen-Belsen et d’y mourir, de soif, de faim, de désespoir et du typhus, à 16 ans. Au début, la romancière de « Chavirer » argue qu’elle a de bonnes raisons. Elle doit obéir au strict principe de la collection « Ma nuit au musée », et la Maison Anne Frank, à Amsterdam, en est devenu un, depuis 1960. Et puis, ses livres ne sont-ils pas peuplés de jeunes filles – dont la gymnaste roumaine Nadia Comaneci et l’héritière américaine Patty Hearst, enlevée à 19 ans par un groupe terroriste d’extrême gauche –, qui, toutes, « se confrontent à l’espace qu’on leur autorise » ? Mais ces raisons sont des leurres. D’ailleurs, c’est à peine si elle connaît la très connue Anne Frank. Elle n’a rien lu à son sujet et n’a qu’un vague souvenir de son « Journal ». Elle préfère se réfugier derrière le credo de Marguerite Duras : « Si on savait quelque chose de ce qu’on va écrire […] avant d’écrire, on n’écrirait jamais. »
La suite après la publicité
Mais Lola Lafon pressent que sa propre histoire, dont elle a cru longtemps pouvoir se détacher afin de mieux avancer dans la vie – « J’ai tourné le dos à l’abîme » –, lui commande ce texte. Juive, elle a des origines russo-polonaises ; elle a grandi en Bulgarie et dans la Roumanie de Ceaușescu, dont sa mère est originaire et où cette dernière s’est cachée pendant la guerre ; et surtout, sa grand-mère, Ida Goldman, arrivée en France en 1933, qui aimait passionnément Bernard Pivot, Jacques Chancel et Eve Ruggieri, a offert un jour à la petite Lola blonde une médaille dorée frappée du portrait d’Anne Frank, avec la consigne de ne jamais s’en séparer et cette injonction : « N’oublie pas. »
La nuit de Lola Lafon, « au bord de l’abîme » dans la maison d’Anne Frank
« GPS », de Lucie Rico (POL)
Ariane a perdu le fil. Au chômage depuis de longs mois, cette journaliste spécialisée en faits divers n’ose plus sortir de chez elle. Trop d’angoisse. Déboussolée, elle peine à s’orienter dans la vie et dans l’espace. C’est comme ça depuis toujours. Elle est née à l’envers, dévoilant d’abord ses fesses et non sa tête. Mais voilà, cette fois, elle n’a plus le choix. Sandrine, sa meilleure amie, la convie à sa fête de fiançailles. Ariane ne peut pas se défiler : elle est témoin. Afin qu’elle ne se perde pas en chemin, Sandrine partage avec elle sa géolocalisation. Sur l’écran du téléphone, l’amie devient un point rouge qu’Ariane suit à la trace.
Peuplée de jeunes cadres dynamiques, amis du futur marié aux « rires de CSP + » et aux narines blanchies de coke, la soirée ressemble à un « séminaire de team building ». Soit une certaine vision de l’Enfer. Mais Ariane tient bon. En revanche, Sandrine disparaît. D’elle, ne subsiste plus que le point rouge sur le téléphone d’Ariane. Point rouge qui se déplace et qu’Ariane, comme hypnotisée, se met à scruter jour et nuit. Qu’est-il arrivé à son amie ?
Avec « GPS », Lucie Rico nous embarque dans un polar burlesque et bizarre
« Crossroads », de Jonathan Franzen (L’Olivier)
Traduit de l’anglais par Olivier Deparis
La suite après la publicité
Et si Jonathan Franzen était le meilleur écrivain français d’aujourd’hui ? Le romancier américain, né en 1959, ne cesse de faire allusion, dans son nouveau livre, à nos gloires littéraires : Camus, Sartre, Colette, Maupassant. Il ne s’assied pas dans le canapé du naturalisme. Il s’y vautre. Il n’explore pas le réel, il l’épuise. Franzen a même annoncé que « Crossroads », avec son bon kilo de papier, n’était que le premier volume d’une nouvelle trilogie.
Il y fait revivre la révolution hippie dans une petite communauté religieuse de la banlieue cossue de Chicago. Le pasteur de la « First Reformed », Russ Hildebrandt, est la bête noire des jeunes de Crossroads, une association de bénévoles qui prêchent la bonne parole sous l’autorité de Rick Ambrose, nouveau collègue de Russ qui, contrairement à son aîné, fait l’unanimité en sa faveur. C’est que Russ est trop attaché à la lettre des Evangiles quand Rick se satisfait d’un discours creux, mais moins rébarbatif, prônant l’amour universel. Avec une parfaite maîtrise narrative, Franzen multiplie les personnages secondaires autour de Russ, à commencer par Marion, sa femme qu’il ne sait plus aimer, et Frances, la dernière recrue de la « First Reformed », une jolie fille qu’il drague sans savoir où il met le pied.
Et si Jonathan Franzen était le meilleur écrivain français d’aujourd’hui ?
« Les Filles d’Egalie », de Gerd Brantenberg (Zulma)
En Egalie, le « sexe vulnérable », ce sont les hommes. Parce qu’ils sont incapables d’accoucher, les femmes exercent le pouvoir et les mènent d’une main de fer. A elles les meilleures études, les postes à responsabilité et les hauts salaires. A eux la garde des enfants, les tâches ménagères et une totale disponibilité sexuelle – à condition qu’ils aient eu la chance qu’une femme leur propose un « pacte protège-paternité » – ou sinon un emploi mal payé dans les « troupeaux de travail ». Ils se voient en outre imposer le port d’un très inconfortable « soutien-verge » et doivent constamment veiller à s’épiler intégralement et à se pomponner. Petronius, fils d’une « membresse » du « Directriçoire de la Société coopérative d’Etat », excédé par ce qu’il estime être une injustice, fonde avec quelques amis le « Virage viril » pour tenter (en vain) de faire évoluer les mentalités.
On rit beaucoup en lisant cette satire, publiée en 1977 et toujours – ô combien ! – d’actualité. En renversant les codes, y compris dans la langue, Gerd Brantenberg met en évidence le flagrant arbitraire du système patriarcal qui régit encore nos sociétés, trop obnubilé par le maintien de ses privilèges pour concevoir une réelle égalité entre les sexes.
La suite après la publicité
« Revenir à Berlin », de Jonathan Lichtenstein (JC Lattès)
Traduit de l’anglais par Claire Desserrey
Un monstre, c’est ce que Hans est devenu, alors qu’il a lui-même été séparé de ses parents à douze ans, fuyant les nazis, comme d’autres enfants juifs allemands, dans le dernier convoi du « Kindertransport ». Hans Lichtenstein arrive en Angleterre en 1939. Il a laissé sa famille et son enfance derrière lui. Une nouvelle vie se présente, qu’il lui faut entièrement inventer. Hans y parvient. Il se forme à la médecine. A vingt ans, il s’engage dans le corps des SAS, est parachuté dans la jungle, crée un dispensaire pour aborigènes en Malaisie. Bien des années plus tard, le voici père de cinq enfants, exerçant la médecine dans un bled paumé du pays de Galles. Il est brutal, injuste, froid, intraitable. Il conduit sa Mini comme une Ferrari, brisant plus d’une fois les essieux du bolide dans les nids-de-poule des imprévisibles routes galloises. Il refuse de parler à ses enfants de son passé, et de leur expliquer pourquoi sa vie, et la leur, ne tiennent qu’à un miracle. Jonathan le vit mal. Il craint ce père qu’il adore. Il sent croître en lui ce mal profond dont il sait qu’il est aussi celui que son père combat quotidiennement sans complètement réussir à le détruire. Etre en vie par erreur – ça pourrait se dire comme ça. « Je suis devenu étranger à moi-même », écrit Lichtenstein. « Toujours à me bagarrer, aller d’échec en échec, hurler, pousser des cris, me rebeller, […] éprouver une solitude intense et implacable et des humeurs si sombres que je les sentais s’enfoncer en moi et m’engloutir. »
Alors que son père est maintenant un vieillard, Jonathan lui propose d’inverser le cours du temps : retourner à Berlin, visiter le quai de gare d’où il était parti, enfant, retrouver les lieux chers, les tombes, les souvenirs. C’est le récit de ce voyage qui sert de colonne vertébrale au premier livre, frémissant et bouleversant, de Jonathan Lichtenstein, aujourd’hui dramaturge et professeur de théâtre à l’université d’Essex. Tandis que Hans retrouve le chemin de son enfance, Jonathan se remémore ses jeunes années à l’ombre de ce père imbuvable et déroutant, une force de la nature qui martyrisait son fils et conjurait par l’excès la perte originelle. Les deux hommes, qui s’étaient toujours regardés en chiens de faïence, apprennent à mieux se connaître. Et tandis qu’il évoque avec pudeur la mort de Hans, enfin réconcilié avec la vie, le récit de Jonathan Lichtenstein fond en larmes et touche à la grâce.
« V13 », d’Emmanuel Carrère (POL)
Emmanuel Carrère est aussi un sacré journaliste. Il fallait l’être pour suivre, pendant un an pour « l’Obs », le procès-fleuve consacré aux terribles attentats du 13 novembre 2015, qui ont traumatisé tout un pays, avec l’assassinat de 131 personnes. Et le livre qu’il a tiré de ses chroniques pourrait bien être, à la hauteur de l’événement, un grand livre.
La suite après la publicité
Mais comment fait-il ? Quelle est cette virtuosité qui permet à Carrère, avec la décontraction du type qui raconte une histoire devant un verre de blanc et quelques cacahuètes, de formuler des choses si fines sur un dossier si compliqué, si douloureux, et encore souvent si mystérieux ? En épousant tous les points de vue possibles, le sidérant kaléidoscope narratif de « V13 » ne se dérobe devant aucune difficulté, aucune zone grise, aucune ambivalence. Jusqu’au vertige, qui nous gagne à chaque page devant la souffrance infinie des victimes, et la folie de ceux qui l’ont causée. Il y a du Tchekhov et du Dostoïveski dans ce journalisme-là. C’est dire si c’est, aussi, de la littérature.
« V13 », la postface : une année avec Emmanuel Carrère
« Fantaisies guérillères », de Guillaume Lebrun (Christian Bourgois)
Charles Péguy peut aller se rhabiller. Claudel, Brecht et Shakespeare aussi, tant qu’on y est. Jeanne d’Arc a enfin trouvé un écrivain à la mesure de sa flamboyance – sans mauvais jeu de mots. Trouvère des temps modernes, ménestrel sans limites, Guillaume Lebrun, dont la biographie sommaire indique qu’il « élève des insectes dans le sud de la France », offre à la Pucelle le livre fougueux et fou à lier que l’épopée johannique attendait depuis des siècles. Son premier roman retrace la trajectoire de celle qui, guidée par des voix, leva le siège d’Orléans, permit à Charles VII d’être sacré roi de France à Reims, et périt sur le bûcher. Mais cette geste iconoclaste ne devrait pas ravir les identitaires et autres nationalistes qui ont fait de la combattante en armure leur icône.
L’histoire est ici racontée tour à tour par Yolande d’Aragon – belle-mère de Charles VII – qui préfère se faire appeler YO et par Jeanne d’Arc herself, ou plus précisément par Jehanne la Douzième. De l’apocryphe de première main, en somme. Et un style médiévalo-queer à dévisser les heaumes, une écriture qu’on dirait née des amours orgiaques de Christine de Pizan et Monique Wittig, François Villon et Mylène Farmer.
« Fantaisies guérillères » ou Jeanne d’Arc racontée par Mylène Farmer et François Villon
« Oh, Canada », de Russell Banks (Actes Sud)
Traduit de l’anglais par Pierre Furlan
La suite après la publicité
Il n’en a plus pour longtemps. Leonard Fife, le héros de « Oh, Canada », est un célèbre documentariste en fin de vie. Dans l’espoir d’enregistrer son dernier soupir, et quelques révélations fracassantes qui pourraient le précéder, une équipe de télé vient le surprendre, chez lui, flanqué de son infirmière et de sa perfusion. Et c’est parti pour la confession de Leonard, qui n’en fait qu’à sa tête et ne répond jamais aux questions de son interviewer. Le nouveau roman de Russell Banks, qui s’est nourri de son propre parcours, est un récit passionnant et testamentaire, autant qu’un requiem pour cette Amérique que Banks a tant aimée, et dont il confie qu’elle ne lui a jamais autant fait peur. Et si c’était les Etats-Unis que le grand romancier auscultait justement sur son lit de mort ?
Russell Banks : « J’ai très peur que le prochain président soit républicain. Et il le sera »
« La Vie clandestine », de Monica Sabolo (Gallimard)
On connaît l’obsession de Monica Sabolo pour le territoire miné de l’adolescence, l’inconséquence des adultes, l’innocence profanée. On se souvient de l’atmosphère de thriller teintée d’onirisme fantastique de « Crans-Montana » et de « Summer », où perçait l’écho de « Virgin Suicides » de Sofia Coppola, et des ses héroïnes éthérées, issues de la bourgeoisie suisse où le silence pèse comme un couvercle, et qui se débattaient pour survivre après avoir été abusées. Puis de la violence inédite d’« Eden », inspiré par la situation dramatique des femmes autochtones en Colombie-Britannique, où là encore une jeune fille est violentée. On sent que de roman en roman Monica Sabolo cherche à s’approcher, à travers ces jeunes femmes meurtries, qui sont comme une image diffractée d’elle-même, d’un point nodal de son existence tout en habillant la douleur de poésie et de beauté pour amortir le choc d’un affrontement trop brutal.
Peut-être a-t-elle buté sur une impasse, ou plus simplement souhaité s’éloigner de son propre vécu, de cette douleur silencieuse et de cette violence rentrée qui la hantent, pour bifurquer, dans ce nouveau roman, vers une « histoire vraie, spectaculaire », « un fait divers, un meurtre », quelque chose de totalement étranger à l’univers romanesque qu’elle avait élaboré jusqu’à présent. C’est en écoutant des épisodes d’« Affaires sensibles » sur France-Inter que son attention a été retenue par l’épisode consacré à l’assassinat de Georges Besse, PDG de Renault, le 17 novembre 1986, par le groupe terroriste d’extrême gauche Action directe. « Je pense, nous dit-elle, que j’ai été happée par mon prisme naturel qui est celui des jeunes femmes, dont Nathalie Ménigon et Joëlle Aubron, qui ont 27 et 29 ans au moment où elles attendent un grand patron sur un banc et l’abattent. » Elle tenait son sujet et allait, comme son ami Philippe Jaenada, « chercher les vérités humaines derrière le fait divers ».
« Dérives », de Kate Zambreno (La Croisée)
Traduit de l’anglais par Stéphane Vanderhaeghe
La suite après la publicité
Quelle sensation étrange de parcourir un livre qui n’existe pas, un livre fantôme. « Dérives », de l’Américaine Kate Zambreno, est un exosquelette littéraire, la carapace translucide d’un texte perpétuellement à venir, celui que la narratrice, double de l’autrice, projette d’écrire depuis des années sans y parvenir. Elle aimerait saisir le présent, contenir dans ses paragraphes « l’hémorragie des jours », le temps qui s’écoule comme le sang, chaque mois, entre ses jambes.
Au lieu de cela, en proie à une « forme fervente de procrastination », variante de ce que Vila-Matas nomme le « syndrome de Bartleby », elle s’absorbe dans la contemplation de son chien Genet affublé d’une mèche blanche à la Susan Sontag, consigne les allées et venues d’un chat à la queue de raton laveur – un « chaton laveur » –, échange des mails avec une amie écrivaine qui, elle, a publié son roman, et divague sur Robert Walser, Ludwig Wittgenstein, Chantal Akerman ou encore Rainer Maria Rilke, qui mit dix ans à écrire « les Cahiers de Malte Laurids Brigge ».
Chatons, masturbation et création : dérivez avec Kate Zambreno
« Le Dernier des siens », de Sibylle Grimbert (Anne Carrière)
La spécificité de Sibylle Grimbert, c’est une constante exploration de l’insondable mystère d’exister et l’imprévisibilité de ses manifestations. Dans ses deux précédents romans, l’écho infini de mondes parallèles déstabilisait et interrogeait jusqu’au vertige. Elle imagine ici l’histoire d’une singulière et touchante amitié entre Gus, un jeune naturaliste mandaté par le Musée d’Histoire naturelle de Lille dans l’Atlantique Nord au début du XIXe siècle, et Prosp, un grand pingouin qu’il a sauvé du carnage et dont il va prendre conscience qu’il est le dernier de son espèce.
L’homme et l’oiseau s’observent et s’apprivoisent. Fasciné par cet être avec lequel il ne partage aucun langage mais « une connaissance intuitive de la vie », « une intersection entre leurs deux mondes », Gus en fait le centre obsessionnel de son existence. Lorsqu’on tente de le lui voler, il déménage aux îles Féroé. Quand il se marie et fonde une famille, Prosp en est un membre à part entière. Gus tente même de le rendre à la vie sauvage, sans succès. Prosp est condamné à l’extinction et Gus en est l’impuissant témoin. Comme une préfiguration de ce qu’il adviendra de notre espèce si elle s’entête dans l’illusion imbécile de sa toute-puissance.
La suite après la publicité
« Questions brûlantes », de Margaret Atwood (Robert Laffont)
Traduit de l’anglais par Michèle Albaret-Maatsch, Odile Demange, Valentine Leys Legoupil, Renaud Morin et Isabelle D. Philippe
D’où vient l’infinie curiosité de Margaret Atwood pour l’aventure humaine sous ses multiples et souvent regrettables manifestations ? Ecrire des articles et des conférences est, pour elle, bien davantage qu’une activité secondaire. Et le fait est que, comme chroniqueuse, elle n’a pas son pareil. Drôle, érudite, pertinente toujours, impertinente parfois, elle n’est jamais tiède dans l’appréciation. Le sens de l’observation, le génie du détail vrai : c’est la marque du bon écrivain, et c’est le cœur de métier de Margaret Atwood.
Dans cette chronique des temps actuels, qui couvre la période 2004-2021, elle dit sa dette à Orwell, parle de la fonte de la banquise arctique (qu’elle a vue, dit-elle, de ses propres yeux), évoque son enfance auprès de son père entomologiste (un des premiers écolos de l’autre côté de l’Atlantique), défend le politiquement incorrect et attaque Trump à la manière d’un bûcheron canadien : « Nous pouvons dire sans trop nous avancer que, sur une échelle de 1 à 100, l’intérêt de Donald Trump pour les arts se situe quelque part entre zéro et moins dix – plus bas que celui de n’importe quel président des cinquante dernières années. Il y a bien eu dans l’histoire du pays des présidents qui se souciaient des arts comme de leur première chaussette, mais, au moins, ils jugeaient habile de faire comme s’ils s’y intéressaient. Trump, lui, ne fera pas semblant. Peut-être ne remarquera-t-il même pas leur existence. »
Margaret Atwood : « Je suis, paraît-il, une mauvaise féministe »
« La Dépendance », de Rachel Cusk (Gallimard)
Traduit de l’anglais par Blandine Longre
La suite après la publicité
Rachel Cusk a été bien inspirée lorsqu’elle a décidé de s’installer il y a quelques mois en France (et de fuir le Brexit, qu’elle déteste). Les dames du Femina lui décernent, avec raison, leur prix étranger pour son nouveau roman, « la Dépendance », un texte passionnant et fascinant, inspiré d’un épisode peu connu de la vie de D. H. Lawrence. Mais, loin de satisfaire aux exigences du roman historique, avec costumes d’époque et mentalités d’un autre âge, Rachel Cusk en tire un roman contemporain sur le monde de l’art, ses excès, ses bassesses. Un monde qu’elle connaît parfaitement puisqu’elle vit avec un artiste en vogue, Siemon Scamell-Katz. Dans son appartement parisien, non loin de République (la partie branchée), des œuvres d’art moderne sont suspendues au mur. Le style loft confortable, avec table en bois précieux et vaste canapé.
Elle s’est donc inspirée d’un texte de Mabel Dodge Luhan, publié en 1932. Un livre épuisé intitulé « Lorenzo in Taos » qui relate le séjour de D. H. Lawrence, chez Mabel, à Taos, au Nouveau-Mexique. Dans « la Dépendance », une romancière sans grand succès est un jour fascinée par l’œuvre d’un peintre dont elle découvre les toiles dans une galerie parisienne. De retour chez elle (elle habite, entre terre et mer, dans une zone de marais en Angleterre avec son mari), elle décide d’inviter le peintre en question dans sa dépendance, qu’elle a transformée en résidence d’artiste. Mais l’arrivée du bonhomme, accompagnée de sa jolie copine, ne va pas tourner comme prévu…
Rachel Cusk, l’Anglaise du Marais couronnée par le prix Femina étranger
« Sempre Susan », de Sigrid Nunez (Editions Globe)
Traduit de l’anglais par Ariane Bataille
La mèche blanche se frayant un passage au milieu de la crinière noire ? Susan Sontag, bien sûr. Susan sans la mèche, c’est comme Castro sans le cigare. « La chimiothérapie, s e souvient Sigrid Nunez, avait seulement désépaissi cette masse extraordinairement dense de cheveux noirs, mais ceux qui repoussaient étaient surtout blancs ou gris. » La mèche était apparue alors qu’elle se remettait d’une mastectomie. Quant à Sigrid, elle avait 25 ans quand elle rencontra pour la première fois l’auteure de « la Maladie comme métaphore ». Sontag était tout bonnement en passe de devenir l’intello numéro un aux Etats-Unis. Convalescente, elle cherchait une secrétaire. C’était au printemps 1976. Susan revenait du Vietnam du Nord et en avait rapporté des sandales Ho Chi Minh en caoutchouc qu’elle aimait porter dans son appartement de Riverside. Sigrid, qui avait été assistante éditoriale à la « New York Review of Books », semblait convenir pour l’aider à traiter la masse de courrier qui s’était accumulée sur son bureau pendant son absence. Elle taperait sous la dictée de Susan sur son « énorme machine à écrire IBM Selectric ». Elle pourrait même dormir sur place, si besoin.
We would like to give thanks to the author of this post for this awesome content
22 livres de 2022 à ne surtout pas oublier
You can find our social media profiles , as well as other related pageshttps://nimblespirit.com/related-pages/